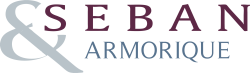Les derniers mois ont vu naître un riche contentieux éminemment politique en matière de temps de travail dans la fonction publique territoriale, à l’occasion des recours engagés par les représentants de l’Etat dans les départements à l’encontre des mesures prises – ou non – par les collectivités pour faire application de leurs nouvelles obligations en la matière.
Rappelons en effet que, par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le législateur a décidé d’abroger le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui prévoyaient la possibilité de déroger au temps de travail de 1607 heures imposées par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, pour les collectivités dans lesquelles un temps de travail inférieur existait avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Les collectivités et leurs établissements publics disposaient d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour adopter une délibération conforme à ces dispositions. Ces délibérations avaient vocation à entrer en vigueur, une fois adoptées, au 1er janvier 2022.
A compter de cette date, l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale devaient donc appliquer un régime de temps de travail fixé sur la durée annuelle de 1607 heures, sous réserve des éventuelles sujétions reconnues pour des fonctions particulières autorisant à abaisser cette durée annuelle.
Pour cette raison, au cours de cette année 2021, certaines collectivités ont voté une délibération appliquant un régime de temps de travail de 1607 heures, qu’elles ont naturellement transmise au préfet au titre de son contrôle de légalité.
Le préfet pouvait alors déférer cet acte au juge administratif, le cas échéant dans le cadre d’une procédure d’urgence, s’il estimait qu’il était contraire aux obligations prescrites par la loi. C’est notamment ce qu’a fait le Préfet de Paris à l’encontre de la délibération de la ville de Paris de juillet 2021.
Le règlement modifié par la délibération avait en effet prévu l’octroi à l’ensemble des agents de la Ville de Paris de jours de congés supplémentaires en considération des « niveaux importants de bruit et de pollution atmosphérique et soumis à des conditions de travail particulières du fait de la sursollicitation du territoire et des services publics ». Ces circonstances constituaient, selon la ville de Paris, une sujétion justifiant une minoration de la durée annuelle de travail de l’ensemble des agents, prenant la forme de jours de congés supplémentaires.
Le Préfet de Paris n’a toutefois pas partagé cette analyse, et a déféré cette délibération devant le Tribunal administratif de Paris, sollicitant en urgence la suspension de cette délibération au regard de l’illégalité dont il l’estimait entachée. Selon le Préfet, on ne pouvait considérer que l’ensemble des agents de la commune était soumis à une sujétion particulière du fait du seul environnement de travail particulier de la ville de Paris.
Le Tribunal administratif, le 25 octobre 2021, puis, saisie à son tour, la Cour administrative d’appel de Paris, le 13 décembre 2021, ont donné raison au Préfet. Les deux juridictions ont estimé que les sujétions justifiant une diminution du temps de travail devaient être propres à chaque fonction exercée, et ne pouvaient résider dans la seule nature de l’environnement de travail de l’ensemble des agents[1].
Ce litige n’a toutefois marqué qu’une première étape dans les rapports entre l’Etat et certaines collectivités quant à la mise en œuvre de l’article 47 de la loi du 6 août 2019.
En effet, selon le Gouvernement, un cinquième des collectivités n’avaient pas adopté de délibération dans les délais prescrits par la loi, avec différentes motivations : pour certaines, les travaux nécessaires à la mise en place d’une délibération ont été très largement retardés par le contexte de la crise sanitaire qui rendait naturellement difficile notamment la mise en place du dialogue social qui cadence la plupart du temps la mise en place d’un nouveau régime de temps de travail, pour d’autres, en revanche, l’abstention à délibérer était volontaire et exprimait une opposition de leurs élus au principe même de la loi.
Estimant que cette abstention méconnaissait, dans tous les cas, les dispositions précitées de l’article 47 de la loi du 6 août 2019, et considérant cette abstention définitivement acquise au 1er janvier 2022, date à laquelle les délibérations, si elles avaient été prises, devaient entrer en vigueur, les préfets ont ainsi décidé d’agir à l’encontre de ces collectivités. N’ayant toutefois manifestement par concerté leur action, les recours engagés par les représentants de l’Etat ont donné lieu à des contentieux différents.
Ainsi le Préfet de la Seine-Saint-Denis a pour sa part décidé d’adresser une demande aux communes du département n’ayant pas encore adopté la délibération en leur enjoignant de lui communiquer la délibération appliquant les 1607 heures.
Les communes ont alors répondu au Préfet qu’elles étaient dans l’impossibilité de transmettre cette délibération, celle-ci n’ayant pas encore été votée, et lui demandaient un délai supplémentaire afin de poursuivre les négociations avec les organisations syndicales.
Le Préfet a saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil de deux requêtes en référé suspension, la première portant sur le refus de communiquer la délibération fixant le nouveau régime de temps de travail, la seconde demandant au Juge d’ordonner, en tant que mesure utile, que la délibération soit prise.
De manière quelque peu surprenante, le Juge des référés n’a communiqué aux communes que la première requête visant à suspendre le refus de communiquer la délibération, sollicitant en outre des injonctions au terme desquelles l’adoption du nouveau régime de temps de travail devait intervenir dans un délai d’un mois sous astreinte de 1 000 euros par agent et par jour de retard.
Ce recours était fondé sur deux moyens tirés de l’absence de communication.
Le choix du Préfet était particulièrement surprenant car aucune disposition du Code général des collectivités territoires (CGCT) ne lui permet de déférer au Juge une telle décision, rendant automatiquement son recours irrecevable.
En effet, les articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du CGCT confèrent la possibilité au préfet de déférer à la juridiction administrative tout acte soumis à son contrôle de légalité ainsi que les autres actes des communes exécutoires de plein droit dont il aurait demandé la communication.
Or, la décision attaquée en l’espèce n’entrait pas dans le champ d’application de ces articles, le refus de transmission d’une délibération ne pouvant être assimilé à aucun des actes mentionnés par le CGCT.
Il était en outre évident que les communes qui n’avaient pas pris la délibération ne pouvaient lui communiquer une décision inexistante.
Le Juge aurait donc dû logiquement faire droit aux fins de non-recevoir soulevées en défense et rejeter pour irrecevabilité les déférés suspension.
Mais le Juge administratif, tout de même conscient de l’irrecevabilité de la demande telle que formulée par le Préfet, a d’une part décidé de requalifier sa demande de refus de communiquer une délibération en refus de prendre la délibération et, d’autre part, d’accueillir un moyen que le Préfet n’avait même pas pris la peine de soulever dans ses écritures, à savoir la méconnaissance de l’article 47 de la loi du 6 août 2019.
Il a en outre enjoint les communes, sous un délai de 40 jours, de transmettre au Préfet la délibération ou tout élément relatif au temps de travail de leurs agents.
Le Préfet se désistait par ailleurs de sa seconde requête, pourtant beaucoup mieux fondée en droit.
Toutefois, considérant les ordonnances rendues irrégulières, les communes ont décidé d’interjeter appel, faisant ainsi valoir la méconnaissance de l’office du Juge, qui a requalifié les demandes mêmes du Préfet ainsi que ses moyens, statuant ainsi bien au-delà des conclusions et moyens dont il était saisi.
Le Juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris bien qu’exprimant à l’audience ses doutes sur la recevabilité de cette requête de première instance, a fait le choix de confirmer les ordonnances, en considérant que le Préfet avait nécessairement entendu saisir le Juge de la question de la légalité du refus de la commune de satisfaire à l’obligation de mettre les règles définissant le temps de travail de ses agents en conformité avec les dispositions de la loi du 6 août 2019 et de prendre en temps utile la délibération[2] .
Un dernier volet s’ouvre avec la saisine annoncée par les communes du Conseil d’Etat à l’encontre de ces ordonnances.
Nul doute que la décision qui sera rendue par le Conseil d’Etat aura une influence certaine sur les jugements à venir du Tribunal administratif de Montreuil sur les déférés « classiques » déposés par le Préfet simultanément à ses déférés suspension, et qui restent encore à juger.
L’action de la Préfète du Val de Marne s’est présentée d’une façon quelque peu différente à l’encontre des collectivités du département. Un total de 11 communes et établissements n’ayant pas délibéré à la date d’émission de la requête – le 3 février 2022 – ont été déférées devant le Juge des référés du Tribunal administratif de Melun. Selon la Préfète, cette abstention manifestait un refus des maires et du président d’établissement « d’appliquer la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 », qu’elle demandait donc au tribunal de suspendre, et d’accompagner sa décision d’une injonction avec astreinte à l’autorité territoriale de veiller à l’adoption d’une délibération en application de ces dispositions, dans un délai d’un mois.
Devant le juge, trois axes de défense principaux ont été opposés.
Un premier axe a été, pour certaines communes, de soulever une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre de la loi, l’estimant notamment contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales puisqu’elle les privait de toute possibilité de définir leur temps de travail librement.
Pour d’autres communes, il était surtout question de se défendre contre les conclusions en injonction de la Préfète : délibérer en un mois sur le temps de travail, sous la pression d’une astreinte importante, comme le demandait la Préfète, n’était tout simplement pas sérieusement envisageable. Les travaux nécessaires à l’élaboration d’une délibération, la consultation du comité technique, la réunion du conseil municipal étaient autant de facteurs qui rendaient impossible l’adoption d’une délibération dans ce délai.
Enfin, un autre ensemble de collectivités se trouvaient dans une situation bien différente : elles soutenaient qu’elles n’avaient aucune volonté de s’opposer à l’application de la loi du 6 août 2019, mais n’avaient, pour diverses raisons, tout simplement pas été en mesure de le faire dans le délai prescrit. Leur défense consistait alors, notamment, à démontrer qu’elles n’avaient pas pris la décision de refus que la Préfète leur imputait, en produisant par exemple des éléments attestant de l’avancée des travaux destinés à permettre la mise en œuvre de la délibération et des difficultés rencontrées pour délibérer dans les temps.
Ces axes de défense ont donné lieu à deux séries d’ordonnances rendues par le Juge des référés du Tribunal administratif de Melun, le 3 mars 2022.
La première catégorie d’ordonnances[3] donnait raison aux communes qui soutenaient être sur le point d’adopter la délibération, le Juge des référés estimant notamment que les travaux mis en œuvre par les services municipaux démontraient une volonté d’appliquer les dispositions de la loi du 6 août 2019, et excluaient donc que l’autorité territoriale soit regardée comme ayant refusé cette application. Pour certaines, la délibération avait même été adoptée entre-temps, ce qui excluait naturellement l’existence d’une décision de refus. Le Tribunal a donc rejeté la requête dans ces litiges, et a même condamné la Préfète au versement des frais irrépétibles, fait suffisamment rare pour être souligné.
La deuxième catégorie d’ordonnances[4] considérait, conformément aux conclusions de la Préfète, que les autorités territoriales des collectivités concernées devaient être regardées comme ayant refusé d’inscrire à l’ordre du jour de leur conseil municipal l’adoption d’une délibération faisant application de l’article 47 de la loi du 6 août 2019. Ce refus a donc été suspendu par le Juge des référés, qui a en revanche largement atténué la sévérité des conclusions de la représentante de l’Etat, en limitant son injonction à un délai de quatre mois à compter de la date de notification de l’ordonnance.
Surtout, le Juge des référés a jugé qu’il y avait lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les communes au Conseil d’Etat. C’est donc désormais à cette juridiction qu’il appartiendra de juger si la question doit être transmise au Conseil constitutionnel. Disposant à cette fin d’un délai de trois mois, le Conseil d’Etat rendra sa décision, au plus tard, le 3 juin 2022.
Pour l’heure, le premier acte, concernant pour l’essentiel un défaut total d’application de l’article 47, a donc pris fin avec ces ordonnances.
L’histoire est pour autant loin d’être terminée. Outre les suites que connaitra ou non la QPC soulevée, à laquelle pourrait se joindre d’autres communes, un nouvel acte débutera une fois les délibérations de ces communes adoptées. Outre l’application d’un régime de principe de 1607 heures, nombre de communes vont faire application des dérogations prévues par la réglementation, et définir une durée annuelle inférieure à ce seuil pour l’ensemble ou une partie de leurs agents, en considération des sujétions particulières de leurs fonctions.
Or, à ce jour, la jurisprudence comme la doctrine est très avare de précisions sur les sujétions qui peuvent être prises en compte, et la diminution de temps de travail qui peut être prévue dans ces cas. Ce flou, c’est à craindre, risque fortement de faire naître une nouvelle série de déférés, car, à l’instar de la ville de Paris, les préfets pourraient ne pas être en accord avec les interprétations qu’auront faites les communes des dérogations à la durée du travail prévues par la réglementation.
Lucie LEFEBURE et Vincent CADOUX
[1] CAA Paris, ordonnance du 13 décembre 2021, n° 21PA05761 (http://paris.cour-administrative appel.fr/content/download/186502/1796969/version/1/file/ordonnance%2021PA05761.pdf).
[2] CAA Paris, ordonnances du 30 mars 2022, n°22PA00703, 22PA00737, 22PA00738 et 22PA00739 (voir pièce jointe).
[3] TA Melun, ordonnance du 3 mars 2022, n°2201146 (http://melun.tribunal-administratif.fr/Media/TACAA/Melun/Decisions/2201146)
[4]TA Melun, ordonnance du 3 mars 2022, n° 2201150, (http://melun.tribunal-administratif.fr/Media/TACAA/Melun/Decisions/2201150)