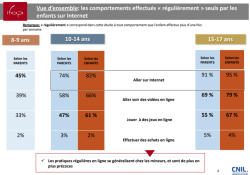Les organismes HLM – c’est-à-dire les offices publics de l’habitat (OPH), les sociétés d’habitations à loyer modéré (ESH) et les coopératives HLM (SCP ou SCIC HLM) – s’interrogent régulièrement sur la nature des participations qu’ils sont habilités à souscrire ou à acquérir.
1. Des facultés de prises de participation limitées par le Code de la construction et de l’habitation
Si le législateur a facilité pour les organismes HLM la recherche de nouveaux modes de production de logements, leur permettant non seulement de faire croître l’offre de logement social mais également de répondre aux demandes des collectivités et habitants tout en développant de nouvelles sources de financement, il n’en demeure pas moins que ces nouvelles activités de diversification doivent nécessairement être conformes au droit à faire des organismes HLM.
Outre le respect du droit à faire, les OPH doivent – en qualité d’établissements publics à caractère industriel et commercial – respecter le principe de spécialité, qui « […] signifie que la personne morale, dont la création a été justifiée par la mission qui lui a été confiée, n’a pas de compétence générale au-delà de cette mission. Il n’appartient pas à l’établissement d’entreprendre des activités extérieures à cette mission ou de s’immiscer dans de telles activités »[1].
Ce principe de spécialité n’ayant pas vocation à s’appliquer aux ESH et aux coopératives HLM, il est régulièrement rappelé par la doctrine[2] que « [l]es sociétés anonymes d’HLM ne sont pas gouvernées par ce principe [de spécialité]. Toutefois, cela a aussi été précisé, la doctrine juridique estime que les sociétés anonymes d’HLM sont régies par un principe de compétence limitée, par le fait que leurs attributions sont limitativement énumérées par le code de la construction et de l’habitation. On ajoutera qu’elles sont spécialement agréées par l’Etat pour le faire. Nous sommes donc portés à conclure, comme le cas des offices publics de l’habitat, que les prises de participation par les sociétés anonymes d’HLM ne doivent pas les conduire, de manière indirecte, à outrepasser le champ de leurs compétences ».
Combiné aux principes de spécialité ou de compétence limitée, le Code de la construction et de l’habitation – énumérant limitativement l’objet social des organismes HLM – tend donc à éviter que les organismes HLM n’exercent, au travers de filiales, des activités qui ne leur seraient pas autorisées.
A ce propos, une étude[3] du Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat (« GRIDAUH »), de 2012, nous semble malgré tout être toujours d’actualité, en ce qu’elle relève que « [l]a diversification des opérations menées ne peut pas conduire à une « banalisation » des opérateurs d’HLM. Les montages complexes réalisés pour mettre en place une coopération entre les organismes de logement social ou un partenariat avec des opérateurs privés ne doit pas faire » perdre leur âme « aux bailleurs sociaux et les assimiler purement et simplement avec les autres opérateurs privés alors que la loi leur attribue une mission bien spécifique ».
2. Les cas limitativement énumérés par le Code de la construction et de l’habitation
Les organismes HLM peuvent ainsi prendre des participations au sein des entités suivantes :
- des sociétés d’habitat participatif[4];
- des sociétés civiles immobilières[5] en vue de leur dissolution par l’actionnaire unique ;
- des sociétés civiles de construction-vente[6] (SCCV destinées à l’accession sociale à la propriété, sauf une exception prévue par la loi ALUR et dont l’interprétation doit rester stricte) ;
- des sociétés d’habitations à loyer modéré[7];
- des sociétés d’économie mixte d’aménagement, de construction et de gestion de logements sociaux[8], s’agissant des OPH ; étant observé que s’agissant des ESH et des coopératives HLM, il est seulement fait mention des « sociétés d’économie mixte »[9] ;
- des sociétés anonymes de coordination d’organismes d’habitations à loyer modéré[10]; autrement dit les « anciennes » sociétés de coordination. A ce propos, il est probable que les textes évoluent aux fins de supprimer la précision d’« anonymes », pour renvoyer aux sociétés de coordination créées par l’article L. 423-1-2 du Code de la construction et de l’habitation, issu de la loi ELAN ;
- des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété (SACICAP)[11];
- de sociétés ou d’organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré[12] ;
- d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du Code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation[13];
- de sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial[14]; étant souligné que cette participation est soumise à un régime d’autorisation préalable du représentant de l’Etat dans le département (et de la collectivité de rattachement pour les OPH) ;
- des sociétés, qui devront avoir la qualité de filiales de l’organisme HLM, ayant pour seul objet de construire et gérer des logements locatifs intermédiaires[15];
- faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’Etat, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues par le Code de la construction et de l’habitation ;
- destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée ci-dessus, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds réglementaires prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
- dont le loyer n’excède pas, pendant la durée mentionnée juste ci-dessus, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs aux plafonds précités.
- de filiales ayant pour objet de construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel[16].
- de filiales ayant pour objet de réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine[17];
- de filiales ayant pour objet de fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits[18].
S’agissant de ces nouvelles filiales, il conviendra de vérifier les éléments suivants :
- la détention par l’organisme HLM de la majorité du capital social de la structure afin qu’elle soit qualifiée de filiale au sens du Code de commerce ;
- le respect du principe de séparation des activités relevant du service d’intérêt général et des autres activités et notamment la question de la provenance des fonds propres investis par les organismes HLM dans ces filiales ;
- la justification d’un intérêt public conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat[19] et à la doctrine administrative[20].
Enfin, il conviendra également de respecter, pour chacun des organismes considérés, le formalisme requis en cas de prise de participation (autorisations administratives ou délibérations préalables des actionnaires, etc…).
Anne-Christine FARCAT
[1] CE, Avis, 7 juillet 1994, Diversification des activités d’EDF/GDF, n° 356089.
[2] B. WERTENSCHLAG, Le logement social en action, Dalloz, 2019, p.316.
[3] E. FATOME et Y. JEGOUZO, Les modes de coopération et de partenariat entre les organismes de logement social ou avec des opérateurs privés dans le domaine de l’aménagement partenariats contractuels et opérationnels, Etude du GRIDAUH, 10 septembre 2012.
[4] CCH, art. L. 421-2, 5°: OPH ; CCH, art. L. 422-2, al. 25 : ESH ; CCH, art. L. 422-3, 12° : Coopératives HLM.
[5] CCH, art. L. 421-2, 8° : OPH ; CCH, art. L. 422-2, al. 28 : ESH ; CCH, art. L. 422-3, 16° : Coopératives HLM.
[6] CCH, art. L. 421-1, 10° et art. L. 421-2, 3° : OPH ; CCH, art. L. 422-2, al. 64 et art. R. 423-75-1: ESH ; CCH, art. L. 422-3, al. 53 et Annexe à l’art. R. 422-6 : Coopératives HLM.
[7] CCH, art. L. 421-2, 1°: OPH ; CCH, art. R. 423-75-1 : ESH et Coopératives HLM.
[8] CCH, art. L. 421-2, 1°: OPH.
[9] CCH, art. R. 423-75-1 : ESH et Coopératives HLM.
[10] CCH, art. L. 421-2, 1°: OPH ; CCH, art. R. 423-75-1 : ESH et Coopératives HLM.
[11] CCH, art. L. 421-2, 2°: OPH ; CCH, art. L. 215-3 : ESH et Coopératives HLM.
[12] CCH, art. L. 421-2, 6°: OPH ; CCH, art. R. 423-75-1 : ESH et Coopératives HLM.
[13] CCH, art. L. 421-2, 7° : OPH ; CCH, art. L. 422-2, al. 26 : ESH ; CCH, art. L. 422-3, 14° : Coopératives HLM.
[14] CCH, art. L. 421-2, 4°: OPH ; CCH, art. L. 422-2, al. 27 : ESH ; CCH, art. L. 422-3, 11° : Coopératives HLM.
[15] CCH, art. L. 421-1, al. 26 – 40 : OPH ; CCH, art. L. 422-2, al. 47- 61 : ESH ; CCH, art. L. 422-3, al. 56 – 70 : Coopératives HLM.
[16] CCH, art. L. 421-1, 19° : OPH ; CCH, art. L. 422-2, al. 65 : ESH ; art. L. 422-3, al. 28 : Coopératives HLM.
[17] CCH, art. L. 421-3, 2° bis : OPH ; CCH, art. L. 422-2, al. 66 : ESH ; art. L. 422-3, al. 29 : Coopératives HLM.
[18] CCH, art. L. 421-4, 6° ter : OPH ; CCH, art. L. 422-2, al. 67 : ESH ; art. L. 422-3, al. 30 : Coopératives HLM.
[19] CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, n°06780 ; CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n°275531.
[20] Rep. min., n°7503 : JO AN, 17 avril 2018, p. 3136, CHALUMEAU P.