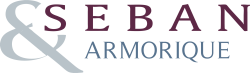Lorsqu’un agent public est victime d’un accident dans l’exercice de son activité accessoire, autorisée par son employeur public auprès de qui il exerce son activité principale, il revient à ce dernier de prendre en charge les conséquences financières de l’accident.
Cette solution confirmée très récemment par le Tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement du 30 mars 2022 (n° 2002407) en matière de fonction publique d’Etat mais parfaitement transposable à la fonction publique territoriale ou hospitalière, à vocation à s’appliquer lorsque l’activité accessoire est accomplie pour le compte d’un autre employeur public.
En l’espèce une enseignante autorisée à cumuler son activité d’enseignement au sein d’un collège public avec une activité accessoire de vacataire auprès d’une Université, a été victime d’un accident de trajet entre le lieu d’exercice de son activité accessoire et son domicile.
Après avoir jugé, en application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, que « la collectivité publique qui emploie un agent doit supporter les conséquences financières d’un accident survenu à l’occasion du service. Lorsque l’agent exerce pour le compte d’une tierce collectivité publique une activité accessoire autorisée par l’employeur principal, cette charge incombe à ce dernier alors même que l’accident est survenu dans l’exercice de l’activité accessoire », le Tribunal a estimé qu’il appartenait au Rectorat, en sa qualité d’employeur principal, et non à l’employeur « accessoire » de prendre en charge les arrêts et soins occasionnés par l’accident de trajet de son agent.
Relevons qu’à la lecture de ce considérant, il semble donc possible de déduire, sous réserve de confirmation ultérieure par la jurisprudence, qu’a contrario, lorsque l’activité accessoire n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable par l’employeur principal, la prise en charge des conséquences financières de l’accident survenu à l’occasion de l’activité accessoire ne saurait incomber à l’employeur public principal.
Le jugement susmentionné rendu par le Tribunal administratif de Bordeaux, qui a le mérite de se prononcer sur une question assez peu posée au juge administratif, est par ailleurs conforme aux dispositions de l’article D. 171-11 du Code de la sécurité sociale en vertu desquelles lorsque les agents de l’Etat et des collectivités territoriales sont victimes d’accidents survenus dans l’exercice d’une activité accessoire accomplie au service de l’Etat, d’un département, d’une commune ou d’un établissement public, ces accidents sont « réparés comme s’ils étaient survenus dans l’activité principale ».
Sur le fondement de ces dispositions, la circulaire relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service (NOR/MCT/B/06/00027/C) du 13 mars 2006 avait ainsi déjà considéré que « l’accident de service survenu au cours d’une activité accessoire accomplie dans le respect de la réglementation sur les cumuls d’emplois pour le compte d’un second employeur public est réparé comme s’il était survenu dans l’activité principale ».
Précisons enfin que le juge administratif semble considérer, en vertu des dispositions de l’article D. 171-5 du Code de la sécurité sociale, qu’à l’inverse, la prise en charge des conséquences financières de l’accident d’un agent public survenu au cours de l’activité accessoire, incombe lorsque celle-ci est exercée pour le compte d’une personne privée (activité salariée ou assimilée), à l’employeur auprès de qui l’agent exerce son activité accessoire et non à l’employeur public principal (voir notamment en ce sens : Cour administrative d’appel de Nantes, 3ème chambre, 20 juin 2002, n° 98NT01891).