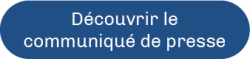Selon le considérant de principe, consacré à de multiples reprises par le juge administratif : « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte, dont aucun élément ne peut être isolé, et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du compte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties »[1].
Le décompte général définitif n’est autre que le document par lequel les cocontractants viennent définitivement clore le marché, sur le plan financier. Cette phase ultime de la relation contractuelle fige les droits et obligations des parties et revêt un enjeu crucial, en raison du caractère intangible du décompte définitif. Le caractère intangible du document, qui limite considérablement les possibilités de remise en compte de celui-ci après acceptation, justifie donc la mobilisation d’une vigilance toute particulière des parties au marché lors de son établissement.
Le caractère intangible du décompte général définitif.
Le décompte général, qui par principe est présenté par l’acheteur public au titulaire du marché, est accepté implicitement ou expressément par ce dernier. Lorsque l’acheteur public, après acceptation de son titulaire, arrête le décompte général ce dernier récapitule notamment les acomptes et le solde du marché. Le décompte acquiert, par suite, son caractère définitif du fait de sa régulière notification et de sa signature.
C’est précisément ce caractère définitif qui lui confère son intangibilité.
Cette intangibilité implique l’absence de modification du décompte définitif. En effet, seul un commun accord entre les parties permet de modifier le contenu de ce document, et ceci à supposer que ladite modification soit justifiée par un motif légitime[2]. En principe, sont également admis comme motif de modification, l’existence d’un dol ou de manœuvres frauduleuses[3]. Cependant, une telle situation reste très rarement admise dans la jurisprudence, et demeure donc anecdotique.
L’intangibilité du décompte a pour principale conséquence de rendre toute contestation impossible.
Ainsi, et en toute logique, le titulaire du contrat ne pourra plus contester le bienfondé d’une créance qui est l’objet d’un titre exécutoire régulièrement émis et résultant du décompte du marché[4].
Toutes les omissions qui auraient été faite à l’occasion de l’établissement du décompte ne pourront plus donner lieu à reconnaissance. Dans cette perspective, l’omission d’appliquer la clause de révision des prix est regardée comme un abandon de créance[5]. De même, le décompte général définitif ne peut être remis en cause en cas d’omission de pénalités.
L’émission d’un titre exécutoire en parallèle du décompte définitif ne saurait pallier les oublis. En effet, même à supposer qu’un titre de recette, portant la référence du décompte général du marché et relatif à des travaux de reprise, ait été émis, le maître d’ouvrage ne peut déduire une somme au titre desdits travaux de reprises du solde dû au titulaire dans la mesure ou ni les travaux de reprises ni leurs coûts n’ont été inscrits au décompte général signé par lui-même.[6]
Face à ce caractère définitif du décompte, un réflexe incontournable consiste à faire état, en son sein, des réserves qui ont été émises lors de la réception et qui n’ont pas été levées. En effet, si le maître d’ouvrage renonçait à faire état de telles réserves, le caractère définitif du décompte aurait pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes qui correspondraient à ces réserves. Sur ce point, le Conseil d’Etat a récemment apporté d’utiles précisions en estimant que les réserves mentionnées au décompte pouvaient être chiffrées ou non et qu’en cas de mention des réserves dans le décompte sans chiffrage celui-ci ne devenait définitif que sur les éléments qui n’auraient pas l’objet de réserves. En revanche, lorsque le maître d’ouvrage chiffre le montant desdites réserves dans le décompte, et que celles-ci n’auraient pas fait l’objet d’une réclamation par le titulaire, le décompte devient définitif dans sa totalité et les sommes correspondant à ces réserves pourront être déduites du solde du marché dans l’hypothèse ou les travaux permettant la levée des réserves n’auraient pas été effectués[7].
Enfin, soulignons que si le caractère définitif est applicable au titulaire du marché il l’est également aux sous-traitants de ce dernier. Par suite, même si le sous-traitant est titulaire d’une créance à l’encontre du maître de l’ouvrage ce dernier ne peut valablement en réclamer le paiement, au titre du paiement direct, des lors que ladite créance n’apparait pas au décompte et que celui-ci a été notifié au titulaire par le maître d’ouvrage[8].
Les conséquences de l’intangibilité du décompte général définitif sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du cocontractant.
Si le maître d’ouvrage estime que la responsabilité de son cocontractant est susceptible d’être engagée, il doit impérativement sursoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance y figure ou assortir le décompte de toutes les réserves utiles. En effet, en l’absence de telles précautions l’intangibilité du décompte risque de faire obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du cocontractant soit engagée.
Une telle solution apparait logique dans la mesure ou le décompte retrace l’intégralité des dettes et des créances nées de l’exécution du marché. Or, une fois arrêté, le décompte met définitivement fin aux droits et obligations des parties entres elles et fait en principe obstacle à ce que à ce que soit mis en cause la responsabilité contractuelle.
Par conséquent, les collectivités locales sont recevables à demander la condamnation du titulaire du marché au paiement de dommage et intérêt, à raison de manquement dans l’exécution du contrat, en amont de l’établissement du décompte définitif [9]. Selon les termes du juge administratif, le maitre d’ouvrage peut ainsi demander à son cocontractant : « réparation sur un terrain contractuel, des conséquences financières de l’exécution des travaux […] au nombre desquels figurent notamment les coûts nés des retards et des travaux supplémentaires ».[10]
Une telle solution a récemment été réaffirmée, et ce avec d’autant plus de force qu’il s’agissait pour le juge administratif de se prononcer sur la responsabilité contractuelle du titulaire après que la résiliation du contrat ait été prononcée aux frais et risques de ce dernier.
En effet, le juge précise qu’en cas de résiliation, bien que la responsabilité des cocontractants ne puisse plus être engagée pour l’avenir, ces derniers doivent néanmoins répondre de leurs actes antérieurs tant qu’aucun décompte général et définitif de résiliation n’a été accepté par les parties. Dans cette espèce, la collectivité publique était donc fondée à demander au juge du contrat la condamnation de son cocontractant à des dommages et intérêts alors même que la résiliation du contrat avait été prononcée[11].
Cependant, il convient d’apporter deux tempéraments à ces propos :
- D’une part, en ce qui concerne l’action en responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement. Pour sa part, une telle action, à supposer qu’elle ait bien été prévue au contrat, reste possible et ce malgré l’intervention du décompte définitif. Cependant, l’engagement de cette responsabilité restera conditionné au fait que la personne publique n’ait pas eu connaissance du litige avant d’établir le décompte général et qu’elle ne l’ait pas assorti de réserve sur ce point[12];
- D’autre part, le maître d’ouvrage peut réclamer au titulaire du marché des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte si le titulaire à lui-même émis des réserves sur une partie des sommes inscrites au décompte général et qu’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves.[13]
Eviter les écueils lors de la procédure l’adoption du décompte général définitif.
Au regard des nombreuses conséquences qu’emportent le décompte général définitif, il est recommandé d’adopter une attitude de vigilance au moment de l’élaboration de ce document.
Ainsi, une attention toute particulière doit donc être portée aux délais prévus par la procédure d’adoption du décompte définitif, que celle-ci soit prévue par le CCAG ou le CCAP. A ce titre, il a pu être jugé que l’opposition expresse de l’acheteur public antérieurement à la notification du projet de décompte final et au mémoire en réclamation qui l’accompagnait ne pouvait empêcher l’intervention tacite du décompte général définitif en l’absence de décompte général adressé dans le délai imparti par ses soins[14].
Par ailleurs, en l’absence de réponse du pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit, le titulaire du marché peut se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite, et ce indépendamment du fait que les parties aient signé un avenant au marché ayant eu pour effet de prolonger le délai d’exécution des travaux des lorsque cet avenant n’avait pas pour objet de déroger aux stipulations du CCAG concernant l’adoption du décompte définitif[15].
Également, un autre point d’attention consiste à ne pas considérer que la réception des travaux avec réserve fasse obstacle au déclenchement des délais donnant naissance à un décompte tacite[16]. A ce titre, il faudra d’ailleurs veiller à maîtriser la distinction entre les notions de « réceptions avec réserves » et « réceptions sous réserve » dans la mesure où ces dernières entrainent des conséquences distinctes. En effet, si le titulaire du marché dispose bien d’un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal de réception des travaux avec réserves pour adresser au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, le projet de décompte final, dans le cadre de la réception sous réserve, il ne peut en revanche se prévaloir du même délai pour transmettre lesdits documents qu’à partir de la date du procès-verbal de levée des réserves[17].
Enfin, en ce qui concerne le titulaire, le défaut de réclamation régulière de ce dernier entrainera l’adoption définitive du décompte. Le titulaire devra donc rester rigoureux dans l’établissement du contenu de cette réclamation préalable dans la mesure où son contenu cristallisera, le cas échéant, sa demande contentieuse devant le juge administratif[18]. Cependant, le Conseil d’Etat a récemment estimé que le titulaire qui ne s’était pas conformé à son obligation de dresser le projet de décompte final conservait tout de même la possibilité de former une réclamation contre le décompte général établi d’office par le maître d’ouvrage, dans un délai de quarante-cinq jours[19].
Léa GIRARD
[1] CE, 8 décembre 1961, Société Nouvelle Compagnie générale des travaux ; CE, 20 mars 2013, Centre Hospitalier de Versailles n° 357636
[2] CE, 13 juillet 1961, Compagnie havraise de navigation à vapeur ; CAA Lyon, 4 juillet 2013, Société BRB Construction, n° 12LY02398
[3] CE, Section, 22 octobre 1965, Commune de Saint-Lary, n° 58876
[4] CAA Lyon, 31 janvier 2013, Société Axe Isolation, n° 12LY00172
[5] CAA Douai, 2 avril 2020, Société ICP, n° 18DA01228
[6] CAA Douai, 1er février 2022, n° 20DA00174
[7] CE, 28 mars 2022, Commune de Sainte-Flaive-des-Loups, n° 450477
[8] CE, 2 décembre 2019, Société FIDES, n° 425204 ; CAA Marseille, 15 juin 2020, n° 18MA02292
[9] CAA Paris, 21 mai 2021, n° 20PA02305
[10] CE, 6 avril 2007, Centre hospitalier général Boulogne-sur-Mer, n° 264490
[11] CAA Nantes, 11 mars 2022, n° 21NT01481
[12] CE, 6 mai 2019, Société Icade Production, n° 420765
[13] CE, 6 novembre 2013, Région Auvergne, n° 361837
[14] CAA Nantes, 30 mars 2020, Communauté d’agglomération du Pays de Dreux, n° 19NT03454
[15] CE, 25 janvier 2019, Société Self Saint-Pierre-et-Miquelon, n° 423331
[16] CAA Versailles, 27 février 2020, Société Ateliers Bois, n° 19VE01401
[17] CAA Bordeaux, 1er juin 2022, n° 22BX00102
[18] CAA Nantes, 14 novembre 1991, SEM du Centre de la France, n° 89NT00283
[19] CE, 19 mai 2022, Société Eiffage travaux publics Nord et autres c/ SIMOUV, n° 455134