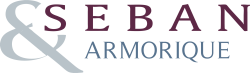- Une obligation vaccinale prévue depuis la loi du 5 août 2021
Les acteurs du secteur médico-social et du secteur de l’économie sociale et solidaire sont au cœur de la lutte contre la covid-19. Eu égard aux spécificités de leur secteurs le législateur a adopté des mesures spécifiques à leur égard à l’occasion de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire[1].
Pour mémoire, cette loi prévoit, ainsi, que les personnels des établissements de soins, médico-sociaux et sociaux listés en son article 12 doivent obligatoirement être vaccinés, sauf contre-indication médicale.
Cette obligation avait fait l’objet d’aménagements transitoires et n’a pris plein effet qu’à compter du 16 octobre 2021.
Aussi, depuis le 16 octobre 2021, les personnels concernés doivent justifier, auprès de leur employeur :
- d’un schéma vaccinal complet ;
- ou ne pas être soumis à l’obligation de vaccination en raison de contre-indication médicale ou d’un rétablissement après une contamination par le COVID-19.
Les professionnels qui ne réalisaient aucune activité médicale et travaillant dans les établissements de la petite enfance avaient, toutefois, après moultes discussions notamment devant le Conseil d’état[2] été exclus de ce dispositif[3].
En tout état de cause et par ailleurs, cette obligation vaccinale ne s’appliquait pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle dans les locaux, prévus à l’article 12 de la loi du 5 août précitée ou elles exerçaient ou travaillaient.
- Une tentative de question prioritaire de constitutionnalité infructueuses le 15 décembre 2021
Dans le cadre d’une contestation de la loi du 5 août 2021 une « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) avait été formulé contre l’obligation vaccinale des salariés travaillant dans le secteur médico-social.
L’objectif de cette QPC était in fine qu’elle soit transmise au Conseil constitutionnel afin qu’il censure l’obligation vaccinale de ces travailleurs.
La QPC posée à la Cour de cassation aux fins de transmission au Conseil constitutionnel était la suivante :
L’article 14 II de la loi du 5 août 2021 est-il contraire au préambule de la Constitution de 1958 qui rappelle l’engagement de la France à respecter les conventions internationales, notamment celles qui interdisent à un pays signataire de priver un travailleur quel qu’il soit de sa rémunération par le recours à différents artifices, notamment une suspension arbitraire de son contrat de travail ?
La Cour de cassation a statué à l’irrecevabilité de cette QPC, en précisant :
- d’une part, que la question ne précise pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte ;
- et, d’autre part, que le grief tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative avec les engagements internationaux de la France ne constitue pas un grief d’inconstitutionnalité (Cass. Soc., QPC 15-12-2021 no21-40.021 FS-B).
La décision de la Cour de cassation s’explique par le fait que le Conseil constitutionnel a seulement le pouvoir de juger la conformité des textes de loi au regard de la Constitution et non des conventions internationales.
- L’intégration d’une troisième dose de rappel au 30 janvier 2022
Dans le cadre de la prolifération exponentielle du variant Omicron, la Direction Générale de la santé a publié une note en date du 10 janvier 2022 intégrant la troisième dose au schéma vaccinal complet des salariés du secteurs médico-social.
Cette note prévoit l’intégration de cette 3ème à partir du 30 janvier 2022, contre le 15 février 2022 pour la population générale[4].
« la réalisation de la dose de rappel sera intégrée dans l’obligation vaccinale applicable aux personnels travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social au 30 janvier 2022 date à laquelle, ils devront donc présenter un schéma vaccinal valide.
Les règles d’application du rappel dans l’obligation vaccinale sont les mêmes que celles applicables au rappel, à savoir l’application du délai de 7 mois au 30 janvier 2022 puis de 4 mois à partir du 15 février 2022 ».
Les personnes bénéficiant d’un certificat de rétablissement peuvent déroger de manière temporaire à cette obligation, pour la durée de validité de certificat, celle-ci étant actuellement fixée à 6 mois.
Les personnes bénéficiant d’un certificat de contre-indication médicale peuvent, également, déroger de manière pérenne à cette obligation, sauf dans les cas où la contre-indication est temporaire.
- Le nouveau projet de loi sur le pass vaccinal : un impact limité sur le secteur médico-social et de l’ESS
Dans ce contexte et à l’issue d’intenses débats parlementaires, un nouveau projet de loi, transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, a été voté à l’Assemblée nationale, ce dimanche 16 janvier 2022.
Ce projet de loi « renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » est actuellement soumis aux fourches caudines du Conseil constitutionnel, qui a été saisi le 17 janvier 2022 par plus de soixante députés et soixante sénateurs, en application de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution[5].
Le Conseil constitutionnel a d’ores et déjà annoncé qu’il rendra sa décision ce vendredi 21 janvier 2022.
Ainsi, sous réserve d’absence de censure, ce projet entend renforcer la lutte contre l’épidémie de Covid-19 par l’adoption de nouvelles mesures générales.
En substance, ce projet de loi impose un pass vaccinal aux salariés jusqu’alors soumis à l’obligation d’un pass sanitaire lorsqu’ils travaillaient dans des établissements recevant du public.
Il intégrera l’obligation d’une troisième dose au schéma vaccinal complet au 15 février 2022 et réduira de 7 à 4 mois la période interstitielle entre la deuxième et cette troisième dose pour bénéficier d’un schéma vaccinal complet.
Il devrait donc avoir un impact limité sur le secteur médico-social pour les professionnels déjà soumis à une obligation vaccinale.
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
[2] CE 25 octobre 2021, référé, n°457230 Conseil d’État (conseil-etat.fr)
[3] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202
[4] COVID 19 : Obligation vaccinale | Agence régionale de santé Normandie (sante.fr)
[5] Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (Dossier législatif en version repliée) – Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)