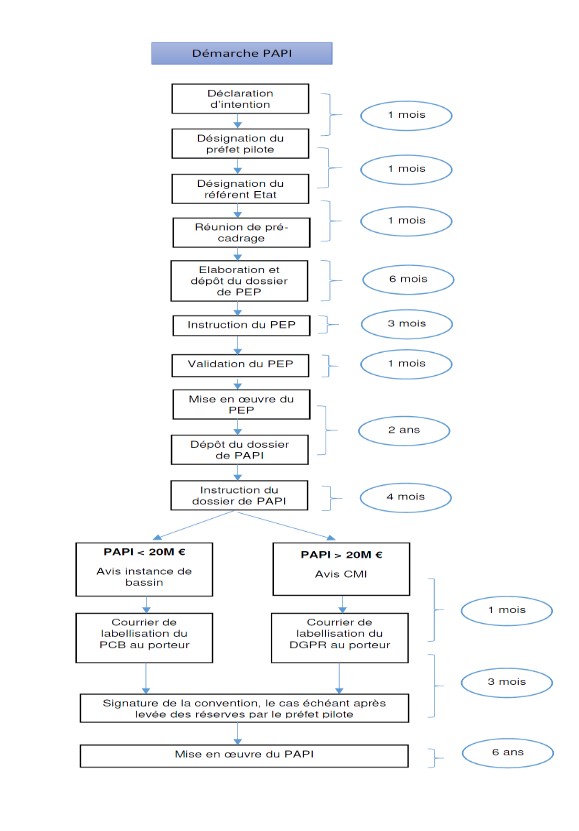Schémas directeurs de développement et nouveau cadre règlementaire
Les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables neufs sont en nette augmentation depuis 2019. Cette forte progression, qui s’explique notamment par la mise en œuvre récente d’un plan de déploiement massif d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE)[1], a vocation à se poursuivre.
Un décret pris en application de l’article 68 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (loi « LOM ») et publié le 10 mai 2021, porte sur les schémas directeurs de développement des IRVE ouvertes au public, lesquels permettent aux collectivités territoriales et leurs groupements qui le souhaitent d’élaborer une stratégie locale de déploiement desdites infrastructures afin de parvenir à une offre de recharge suffisante sur leur territoire. Ce texte, qui apporte de nombreux éclaircissements concernant la réalisation, la validation ainsi que l’actualisation desdits schémas, s’accompagne de la parution d’un guide exhaustif en la matière à destination des collectivités et établissements publics établi par le ministère de la transition écologique. Issu d’une importante concertation avec les acteurs de la filière, il devrait largement soutenir le développement des IRVE (I).
Ensuite, la poursuite d’une transition généralisée vers l’électromobilité par une amélioration du service rendu aux utilisateurs de bornes de recharge est soutenue par un décret portant modification du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux IRVE. Ce décret, publié le 4 mai dernier, qui était très attendu par la filière de l’électromobilité, établit un cadre règlementaire qui devrait permettre auxdits usagers de bénéficier d’infrastructures optimisées ainsi qu’une prise en charge renforcée de ces dernières en termes de maintenance (II).
Les nouveaux textes :
Le guide du ministère de la transition écologique à l’attention des collectivités et établissements publics :
I. Les schémas directeurs de développement des IRVE
La loi LOM a créé la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements titulaires de la compétence IRVE d’élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public (ci-après « schémas directeurs »).
Rappelons que, sauf dans le cas de métropoles ou de communautés urbaines qui exerceraient cette compétence de plein droit, celle-ci incombe initialement aux communes en vertu de l’article L.2224-37 du Code général des collectivités territoriales. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, il est néanmoins loisible aux communes de transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) exerçant des compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité (AODE) ainsi qu’aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM).
Dans la mesure où, à compter de 2022[2], seuls les territoires couverts par un schéma directeur pourront bénéficier de la prise en charge de 75% de leur raccordement au réseau de distribution d’électricité, de nombreux schémas directeurs de développement devraient voir le jour (art. 68 de la loi LOM).
Il est utile d’exposer les principaux points d’attention sur ces schémas directeurs :
Réalisation d’un schéma directeur commun
En ce qui concerne les éléments de précisions importants introduits par le décret du 10 mai 2021, celui-ci prévoit que différentes entités peuvent élaborer de concert un schéma directeur dès lors que ce dernier a vocation à s’appliquer sur un territoire constituant un ensemble d’un seul tenant (art. R. 353-5-7 du Code de l’énergie). Comme cela est indiqué dans le guide à l’attention des collectivités et établissements publics de mai 2021, une telle mutualisation des expertises et des ressources est susceptible de permettre une meilleure cohérence territoriale, l’établissement d’un schéma sur un trop grand périmètre – tel qu’à l’échelle régionale par exemple – étant cependant déconseillé.
Articulation entre le schéma directeur et d’autres documents de planification
Le nouveau décret précise par ailleurs que lorsque la personne chargée d’élaborer le schéma directeur est également en charge de l’élaboration du plan de mobilité (PDM) ou du plan climat-air-énergie territorial (PCAET), ces documents tiennent lieu de schéma directeur dès lors qu’ils respectent les exigences des articles R.353-5-1 à R.353-5-9 du Code de l’énergie (art.R.353-5-1 du Code de l’énergie).
En tout état de cause, si, le cas échéant, l’entité chargée de la réalisation du PDM ou du PCAET diffère de celle qui est responsable de la conception du schéma directeur, cette dernière devra recueillir auprès de la première collectivité les éléments devant être pris en compte par le schéma directeur.
Etapes d’élaboration du schéma
S’agissant plus spécifiquement des étapes d’élaboration d’un schéma directeur, le décret du 10 mai 2021 indique que celui-ci comprend un (1) diagnostic, un (2) projet de développement et des objectifs chiffrés, un (3) calendrier de mise en œuvre précisant les ressources à mobiliser ainsi qu’un (4) dispositif de suivi et d’évaluation.
Mise en œuvre d’une concertation
En amont toutefois de cet exercice de planification que constitue la conception d’un schéma directeur mais également de façon ponctuelle, tout au long des différentes étapes de sa constitution, plusieurs acteurs doivent participer à une concertation dont les conditions d’organisation sont librement fixées par la collectivité en charge de l’établissement du schéma précité. Il s’agit d’une concertation ayant notamment pour objectif de sensibiliser les entités en présence aux problématiques soulevées par le déploiement des IRVE, d’identifier les différents besoins locaux et de parvenir à la définition d’un projet adapté à ces derniers.
En outre, aux termes de l’article R.353-5-2 du Code de l’énergie, doivent y participer la région, les gestionnaires de voirie concernés, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution publique d’électricité concernés et, lorsqu’elles ne sont pas chargées de l’élaboration du schéma directeur, les autorités organisatrices de la distribution d’électricité, les autorités organisatrices de la mobilité, les acteurs publics ou privés qui sont aménageurs d’infrastructures de recharge ouvertes au public sur le territoire couvert par le schéma directeur, ainsi que toute personne amenée à assumer la responsabilité d’aménageur de nouvelles infrastructures de recharge.
De plus, le guide susmentionné préconise d’associer à cette consultation les communes et EPCI compétents pour la gestion du stationnement du fait de leur connaissance du parc, tout comme d’associations d’usagers de véhicules électriques ainsi que celle d’entreprises du domaine de la logistique et du tourisme.
Établissement d’un diagnostic
Durant une période dont la durée est estimée entre six et huit mois par les rédacteurs du guide susmentionné, la personne chargée de la réalisation d’un schéma directeur doit établir un diagnostic comprenant (art. R.353-5-3 du Code de l’énergie) :
- Un état des lieux de la mobilité électrique et de l’utilisation des infrastructures de recharge ouvertes au public existantes réalisé eu égard, d’une part, aux données statiques disponibles sur la plateforme publique gouv.fr, lesquelles correspondent aux caractéristiques techniques des stations et des points de recharge de véhicules électriques ouverts au public et, d’autre part, au regard des données dynamiques fournies par les opérateurs s’agissant de la manière dont ces stations et bornes sont utilisées en pratique.
- Une évaluation de l’évolution des besoins en infrastructures de recharge ouvertes au public (i) à une échéance de long terme, supérieure ou égale à cinq ans et (ii) à une échéance de moyen terme de trois ans au plus. Cette évaluation est entreprise au vu d’une analyse de l’existant ainsi qu’au regard des spécificités territoriales qui sont susceptibles d’impliquer des usages variés de la mobilité électrique. Un profil type des utilisateurs du territoire doit également être dressé.
- Une évaluation du développement de l’offre de recharge induit par la mise en œuvre de dispositions législatives et réglementaires ou par des projets éventuels d’implantation d’infrastructures de recharge ouvertes au public. Il s’agit d’une étude des projets publics et privés planifiés dans le périmètre du futur schéma directeur aux fins de permettre une coordination optimale des différents projets.
- Une évaluation, fournie par les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité concernés, des capacités d’accueil d’infrastructures de recharge ouvertes au public par le réseau à une échéance de long terme, supérieure ou égale à cinq ans, et, d’autre part, à une échéance de moyen terme de trois ans au plus. Cette évaluation menée en collaboration avec les gestionnaires de réseau a notamment vocation à éviter que des extensions de réseau soient entreprises inutilement.
Identification des priorités et définition des objectifs poursuivis par la collectivité
Sur la base des concertations engagées avec les différents acteurs du territoire et des résultats du diagnostic précité, il appartient à la collectivité sur laquelle pèse la réalisation du schéma directeur d’établir une stratégie territoriale consistant notamment en la définition des priorités de déploiement des points et stations de recharge, en l’établissement d’une articulation entre les offres privées et les offres publiques ainsi qu’en la détermination d’un modèle économique de déploiement viable, le tout en s’efforçant de garantir la mise en œuvre d’une politique de tarification cohérente et attractive pour les futurs utilisateurs (art. R.353-5-4 du Code de l’énergie).
Description du calendrier de mise en œuvre précisant les ressources à mobiliser
La mise en œuvre de ce calendrier d’actions est l’occasion pour la collectivité ou l’établissement public de définir les moyens techniques et financiers à engager dans le but d’atteindre les objectifs identifiés (art. R.353-5-5 et R.353-5-9 du Code de l’énergie). Une illustration du calendrier pouvant être élaboré est à cet égard proposée dans le guide précité. Ses rédacteurs y présentent notamment deux scénarios destinés à permettre à la collectivité de parvenir au déploiement d’une infrastructure. À titre d’exemple, le premier consiste à déployer un faible nombre de stations de recharge et ce, à leur capacité maximale, avec un maillage minimal et d’y installer progressivement de nouvelles stations tandis que dans le second scénario, il est question de déployer un grand nombre de stations avec un effectif de points de recharge limités (2 au minimum), et augmenter la capacité des stations progressivement en fonction de l’évolution des besoins.
Validation du schéma directeur
Après une première adoption, un projet de schéma directeur accompagné d’un fichier comprenant les principales données chiffrées du diagnostic et des objectifs retenus est transmis pour avis au préfet de département. Sans réponse dans un délai de deux mois ou après validation du préfet, le schéma directeur est réputé approuvé. Dans le cas contraire, le schéma est modifié pour tenir compte de l’avis du préfet et est soumis à une nouvelle adoption par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public. Les différentes données contenues dans le fichier susmentionné doivent être rendues publiques par ces derniers sur data.gouv.fr dans un délai de deux mois (art. R. 353-5-6 du Code de l’énergie).
Actualisation du schéma directeur
La mise à jour du schéma directeur requiert, au regard de l’actualisation préalable du diagnostic et d’une évaluation chiffrée, la définition de nouvelles échéances de moyen et long terme. Le schéma actualisé est adopté à l’issue du même processus d’approbation que celui qui prévaut en matière de validation (art. R.353-5-9 du Code de l’énergie).
Au total, si les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’IRVE bénéficient dans ce nouveau cadre d’une certaine marge de manœuvre pour définir les modalités d’élaboration de leurs schémas directeurs, leur adoption devrait dans tous les cas favoriser un maillage territorial optimisé en renforçant la maitrise des risques et des coûts induits par le développement sur leur territoire d’IRVE.
II. Modification du décret du 12 janvier 2017 relatif aux IRVE
Pris en application cette fois-ci de l’article 67 de la loi « LOM », le décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, venu partiellement modifier le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux IRVE et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, contrairement au précédent décret étudié, concerne tout autant les IRVE ouvertes aux publiques que celles qui ne le sont pas et entend favoriser la qualité de services offerts aux utilisateurs ainsi qu’une meilleure interopérabilité et maintenance des bornes de recharge.
Il sera exposé les principaux apports de ce texte :
Élargissement du champ d’application du décret IRVE de 2017
Le décret du 4 mai 2021 retire du premier article du décret de 2017 la référence faite aux « véhicules de catégorie L, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dont la puissance maximale de recharge ne dépasse pas 2 kW » auxquels ce décret n’était pas applicable jusqu’alors. Le décret de 2017, tel que nouvellement modifié, comprend désormais un chapitre III pleinement consacré aux points de recharge réservés à ce type de véhicules.
Introduction de nouvelles définitions
Au-delà de la correction de certaines confusions rédactionnelles présentes au sein de l’article 2 du décret du 12 janvier 2017 consacré aux définitions afférentes au champ lexical des IRVE – l’on songe notamment à la définition de la station de recharge ou bien encore à celle du point de recharge qui méritaient d’être rectifiées -, le nouveau décret définit notamment et ce, de façon inédite, les contours de la notion essentielle « d’interopérabilité », laquelle se caractérise dorénavant comme étant « la capacité d’un composant ou d’un ensemble de composants d’un système utilisé pour la recharge d’un véhicule électrique à fonctionner avec d’autres composants ou systèmes de même finalité sans restriction de mise en œuvre ou d’accès à la recharge, en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes mécaniques, électriques et de protocoles d’échanges de données ».
Mise à disposition des données des stations de recharge
En outre, s’agissant de la mise à disposition des données des stations de recharge, il est constant que pèse sur l’opérateur d’infrastructure une obligation d’utilisation d’un système de supervision qui permet notamment l’échange de données avec chaque point de recharge (art.11 du décret du 12 janvier 2017 modifié). Le nouveau décret exonère toutefois de cette obligation l’aménageur « qui met à la disposition du public une seule station de recharge d’une puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA, de 5 points de recharge au plus, et qui n’est pas intégrée à un réseau d’infrastructures de recharge », lequel demeure tout de même tenu de s’assurer notamment de l’état de fonctionnement des points de recharge (art.12 du décret du 4 mai 2021).
De plus, en sus des données relatives à la localisation géographique ainsi qu’aux caractéristiques techniques des stations et points de recharge ouverts au public, lesquelles doivent être accessibles sur la plateforme publique data.gouv.fr (voir en ce sens l’arrêté du 4 mai 2021 relatif aux données concernant la localisation géographique et les caractéristiques techniques des stations et des points de recharge pour véhicules électriques), l’aménageur doit désormais rendre publique l’indisponibilité d’une infrastructure de recharge résultant d’un incident affectant l’utilisation de tout ou partie de cette dernière pendant plus de deux heures (art.14 du décret du 4 mai 2021).
Qualité du service rendu aux usagers
Sur ce point enfin, il ressort du récent décret que les travaux de maintenance sur les IRVE doivent dès à présent être effectués par des professionnels habilités (art.15 du décret du 4 mai 2021). De plus, les éléments constitutifs des infrastructures ouvertes au public doivent désormais être soumis à des exigences techniques à des fins de sécurité, de fiabilité et d’interopérabilité (art.18 du décret du 4 mai 2021). En ce sens, ces mêmes IRVE seront dorénavant contrôlées au moins une fois par an par une personne ou un organisme compétent (art.17 du décret du 4 mai 2021). Par ailleurs, il importe de souligner que l’article 15 du décret du 4 mai 2021 impose désormais la réalisation d’une étude de conception électrique pour tout projet de création d’une infrastructure de recharge dans un parc de stationnement comportant au moins 50 places ainsi que dans les bâtiments d’habitation collectifs pour tout projet de création d’une infrastructure de recharge prévoyant au moins quatre points de charge.
De façon générale, le nouveau décret fait peser sur l’aménageur d’une IRVE ouverte au public une obligation de prendre « les mesures appropriées pour assurer la continuité du service de recharge » (art.17 du décret du 4 mai 2021).
Par Thomas Rouveyran
–
[1] Voir notre précédent article dans la Lettre d’actualités juridiques Energie & Environnement de Seban & Associés de février 2021 : « Planification 2020/2021 : un soutien renforcé au déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques ». (https://www.seban-associes.avocat.fr/planification-2020-2021-un-soutien-renforce-au-deploiement-des-bornes-de-recharge-pour-vehicules-electriques/)
[2] Le projet de loi Climat et Résilience actuellement débattu devant le Parlement pourrait toutefois prévoir que ce dispositif incitatif soit prolongé au 30 juin 2022.