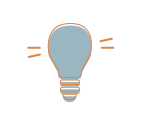Il n’existe aucune statistique fiable en matière de recensement des disparitions de personnes, même si le chiffre global oscille entre 50.000 et 70.000 disparitions par an, dont près de 40.000 mineurs, selon certaines sources.
Si dans la plupart des cas, la personne disparue est retrouvée saine et sauve, il arrive que pour un certain nombre d’entre elles, cette disparition soit qualifiée d’inquiétante.
Dans tous les cas de figure, mais plus encore lorsque cette disparition est de nature inquiétante, dès qu’un service de police ou de gendarmerie a la connaissance d’un signalement de disparition, celle-ci doit d’être traitée avec le plus grand professionnalisme et la plus grande rigueur.
Malheureusement, il arrive encore trop souvent que la famille d’une personne disparue se trouve désemparée face à une telle situation, sans réussir à obtenir l’aide qu’elle est en droit d’attendre des pouvoirs publics, parce qu’elle est confrontée :
- soit à un manque d’écoute attentive de la part du personnel d’accueil du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, invoquant encore trop souvent un délai d’attente de 24 à 48 heures, pour une prise en compte de la demande, alors que ce délai n’a aucune existence légale ;
- soit à un défaut de reconnaissance immédiat du caractère inquiétant de la disparition, qui conduit le policier ou le gendarme à ne pas adopter les bons réflexes pour optimiser les chances de découvrir la personne disparue vivante et en bonne santé.
Or, et surtout dans le cas d’une disparition inquiétante, il est primordial et même vital, que les bonnes décisions soient prises au moment même où le signalement est porté à la connaissance des services de police ou de gendarmerie.
Par ailleurs, tout signalement de disparition de mineur ou de majeur protégé est systématiquement et obligatoirement considéré comme une disparition inquiétante (Article 74-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale).
I. Conditions d’ouverture d’une enquête pour disparition inquiétante
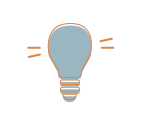 |
Il est utile de savoir qu’il existe deux types d’enquête en matière de disparition inquiétante. |
I.1) – L’enquête judiciaire prévue par l’article 74-1 du Code de procédure pénale.
L’article 74-1 du Code de procédure pénale, prévoit que la décision d’ouvrir une enquête judiciaire pour disparition inquiétante soit prise ;
- dès qu’elle concerne une disparition qui vient d’intervenir ou d’être constatée ;
- et qui présente un caractère inquiétant dès lors qu’elle concerne :
- un mineur ;
- un majeur eu égard aux circonstances, à son âge, à son état de santé ou encore à sa situation personnelle (placement sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice).
Il convient de préciser que la procédure pour disparition inquiétante ne s’applique pas quand, au moment du signalement, l’enquêteur dispose d’éléments permettant de soupçonner un enlèvement.
Dans ce cas précis, les faits étant constitutifs d’un crime, les dispositions de l’article 74-1 du Code de procédure pénale ne s’appliquent pas.
I.2) – L’enquête administrative prévue par la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, art.26.
L’article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, prévoit qu’une enquête peut être ouverte sous la forme administrative dès lors :
- qu’aucun élément ne laisse présumer que la disparition résulte d’un crime ou d’un délit ;
- qu’elle ne vient pas d’intervenir ou d’être constatée ;
- mais qu’elle reste néanmoins inquiétante pour les proches.
Dans ce cas précis, l’enquêteur n’agit pas sur directives du procureur de la République et ce type d’enquête n’a vocation qu’à retrouver la personne sans en rechercher une cause infractionnelle (il s’agit avant tout de recherches opérationnelles, sur le terrain).
Dans les faits, cette procédure est très peu mise en œuvre et dans tous les cas, si l’enquêteur venait à découvrir des indices laissant présumer la commission d’une infraction ou si les dispositions de l’article 74-1 du CPP se devaient d’être appliquées, le procureur de la République doit en être immédiatement informé, mettant fin aux recherches administratives pour déclencher l’ouverture d’une enquête judiciaire.
II. Déroulement de l’enquête pour disparition inquiétante
II.1) – Le recueil du signalement
Point de départ de l’enquête, le service de police ou de gendarmerie saisi par les proches d’un signalement de disparition inquiétante, devra s’attacher à :
a) – recueillir un maximum d’informations concernant :
- l’identité de la personne disparue ainsi que toutes informations utiles la concernant ;
- sa description physique et vestimentaire (photographie la plus récente possible);
- sa situation sanitaire, médicale et sociale ;
- sa famille, ses relations amicales et professionnelles ;
- sa situation financière ;
- ses moyens de locomotions.
b) – sécuriser tout élément permettant d’identifier la personne disparue à partir :
- de son profil génétique (brosse à dents, à cheveux, etc.) ;
- de son schéma dentaire (autrement appelé odontogramme).
II.2) – Les actes de procédure
Dès le signalement pour disparition inquiétante et l’ouverture d’une enquête judiciaire, sauf avis contraire du procureur de la République, la personne disparue doit faire l’objet d’une inscription au FPR (Fichier des Personnes Recherchées), y compris dans le cadre d’une enquête administrative.
Lorsqu’une enquête judiciaire de disparition inquiétante est ouverte par le procureur de la République, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62 du CPP.
Ainsi, l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) peut, dans les mêmes conditions que dans le cadre d’une enquête de flagrance :
- procéder à des perquisitions et à des saisies – (art. 56 à 59 du CPP) ;
- requérir toutes personnes qualifiées (notamment en matière de téléphonie, de vidéo surveillance ou bancaire) – (art. 60 à 60-2 du CPP) ;
- interdire à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture des opérations – (art. 61, al. 1 du CPP) ;
- convoquer et procéder à l’audition de toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur cette disparition ou sur les objets et documents saisis – (art. 61, al. 2 à 5 du CPP) ;
- et, si les nécessités de l’enquête l’exigence, l’OPJ peut retenir sous contrainte, toute personne jugée suspecte ou récalcitrante, le temps strictement nécessaire à son audition, sans toutefois excéder quatre heures – (art.62 du CPP).
 |
Aucune mesure de garde à vue ne peut être prise à l’encontre d’une personne dans le cadre de l’article 74-1 du Code de procédure pénale. |
II.3) – La durée de la procédure
Au cours de cette enquête, qui ne peut durer que 8 jours maximum à compter des instructions du procureur de la République, si des éléments laissant présumer que la disparition résulte d’un crime ou d’un délit venaient à apparaitre, le cadre judiciaire de droit commun doit s’appliquer immédiatement.
Dans tous les cas, au-delà ce délai de 8 jours, les recherches doivent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire ou par l’ouverture, sur réquisition, d’une information judiciaire pour recherche des causes d’une disparition, spécifiquement prévue à l’article 80-4 du Code de procédure pénale.
II.4) – Cas particulier de la diffusion INTERPOL
La demande d’émission d’une notice jaune est faite par l’intermédiaire du Bureau Central National (BCN), directement par le service de police ou de gendarmerie saisi de la disparition.
La notice est ensuite publiée dans la base de données INTERPOL ce qui permettra de mettre en alerte les autorités de police de tous les pays membres du réseau INTERPOL.
III. Issue de la procédure
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter à l’issue de l’enquête ouverte pour disparition inquiétante.
III.1) – La personne disparue est retrouvée vivante et en bonne santé
En absence de cause infractionnelle, le procureur de la République classe définitivement l’affaire.
 |
Si la personne retrouvée est majeure et qu’elle ne souhaite pas communiquer son adresse au requérant elle est libre de le faire – dans ce cas précis le requérant aura simplement connaissance du fait que la personne a été retrouvée saine et sauve. |
III.2) – La personne disparue est retrouvée décédée ou blessée
- La mort ou les blessures sont d’origine criminelle:
Le procureur de la République peut décider de l’ouverture d’une enquête préliminaire ou en flagrance si les conditions sont réunies, voire requérir l’ouverture d’une information judiciaire.
- La mort ou les blessures ne sont pas d’originelle criminelle :
Le procureur de la République classe alors l’affaire sans suite.
- Les causes de la mort ou des graves blessures sont inconnues ou suspectes:
Le procureur de la République peut ordonner l’ouverture d’une enquête de découverte de cadavre ou de découverte de personne grièvement blessée ou bien requérir l’ouverture d’une information judiciaire pour recherche des causes de la mort, dans les conditions prévues à l’article 74 du Code de procédure pénale.
III.3) – La personne disparue n’a pas été retrouvée
Le procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information judiciaire pour rechercher les causes de la disparition comme prévu aux articles 74-1 et 80-4 du Code de procédure pénale.
Il est également envisageable d’ouvrir une enquête préliminaire ou une instruction sur une qualification d’enlèvement et séquestrations voire meurtre si certains éléments de l’enquête orientent vers une piste criminelle.
III.4) – Les recours possibles
Selon la suite donnée par les autorités judiciaires, des recours sont toutefois possibles.
En effet, la victime peut d’initiative déposer plainte soit directement au Commissariat ou à la Gendarmerie sur la qualification d’une infraction (meurtre, enlèvement, séquestration etc…) ou si elle souhaite directement saisir un juge d’instruction à l’aide d’une plainte avec constitution de partie civile.
Il convient de souligner qu’un avocat peut accompagner la victime aux services de police ou de gendarmerie afin de garantir que sa plainte soit prise puis enquêtée.De la même manière, un avocat peut rédiger la plainte avec constitution de partie civile pour saisir efficacement un juge d’instruction.
Retrouvez ici notre focus du mois de janvier 2025 sur les recours possibles pour les familles de personnes disparues.
IV. La prescription
 |
En cas de recherches infructueuses, il est important de préciser que la disparition ne se prescrit pas ; aussi, même si l’enquête ou l’instruction est clôturée, la survenance de faits nouveaux pourra toujours justifier la reprise de nouvelles investigations. |
V. Conclusion
Les familles sont trop souvent démunies face à la disparition d’un proche.
Il existe pourtant des moyens juridiques pour que des recherches effectives soient déclenchées et rapidement.
C’est pourquoi, il ne faut pas hésiter à prendre conseil auprès d’un avocat dès le début de la procédure.
L’accompagnement des familles par leur conseil au moment du signalement de la disparition, oblige bien souvent les autorités judiciaires et policières à prendre en compte sérieusement leur parole et à mettre en œuvre tous les moyens opérationnels et procéduraux pour retrouver leur proche.
Nous contacter