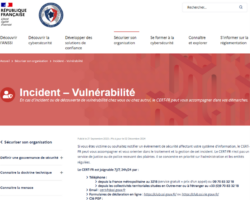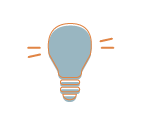La réforme des services à domicile initiée par l’article 44 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 occupe depuis quelques mois les esprits des gestionnaires et des autorités que sont les ARS et les conseils départementaux. En effet, les différentes échéances prévues par la réforme arrivent bientôt à leur terme… pourtant sur le terrain, les gestionnaires ne sont pas encore prêts.
- La création d’une seule catégorie de services, les services autonomie à domicile (SAD) : quel calendrier ?
Un petit rappel s’impose au vu de la légère « complexité » de la réforme : elle prévoit la transformation progressive des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) et des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) en une catégorie unique de structures, les services autonomie à domicile (SAD)[1]. L’objectif est d’inscrire tous les intervenants de l’aide et du soin à domicile dans une démarche de prise en charge globale, dans une « logique de parcours » face au constat d’un besoin accru de coordination autour de la personne âgée et en situation de handicap.
Le Code de l’action sociale et des familles distingue toutefois deux catégories de SAD :
- les SAD dits « mixtes » qui dispensent de l’aide et de l’accompagnement et qui sont autorisés par l’ARS et le conseil départemental et
- les SAD dits « non-mixtes » ou « aides » qui ne dispensent que de l’aide et qui sont autorisés par le conseil départemental.
Les ex-SAAD et SPASAD, réputés autorisés comme SAD non-mixtes pour la durée de leur autorisation, doivent, d’ici le 30 juin prochain, se mettre en conformité avec le cahier des charges des SAD annexé au décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile.
La situation des SSIAD est quelque peu différente. En effet, ces derniers doivent se transformer en SAD mixtes, c’est-à-dire en services proposant à la fois du soin et de l’aide pour les personnes accompagnées. Concrètement, les SSIAD doivent déposer une demande en vue de leur autorisation auprès de l’ARS et du conseil départemental, en qualité de SAD mixtes, d’ici le 31 décembre 2025. Précision et non des moindres : le SAD mixte doit être porté par une entité juridique unique.
Ainsi, les ex-SAAD et SPASAD et les SSIAD ne sont pas sur un pied d’égalité puisque ces premiers peuvent, eux, continuer à ne dispenser que des prestations d’aide et d’accompagnement (et constituer un SAD « aide » non mixte) à condition toutefois d’organiser une réponse aux besoins de soins des personnes avec d’autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions.
Cette transformation, qui impose aux SSIAD de se rapprocher d’un ex-SAAD[2], est ainsi obligatoire et non facultative, comme l’auraient souhaité (et l’espèrent intimement encore) de nombreux gestionnaires.
Et les conséquences en cas d’absence de demande d’autorisation de SAD mixte ne sont pas des moindres puisque, dans ce cas, l’autorisation de SSIAD devient caduque[3].
- Quelles sont les difficultés sur le terrain ?
Sur le terrain, on constate que les SSIAD peinent à se regrouper dans une entité juridique unique avec un SAD. En effet, ils sont confrontés à plusieurs difficultés.
Tout d’abord, celle de faire coïncider les zones d’intervention des différents services dans le cadre de la constitution d’un SAD mixte, exigence imposée depuis le décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile. Cette exigence complexifie nettement les rapprochements et imposent des redécoupages des autorisations préexistantes qui nécessitent l’aval des autorités (réduction, augmentation, scission, etc.).
Ensuite, celle liée aux différences de statut des services existants (souvent privé lucratif ou non pour les SAAD gérés par des associations ou des sociétés commerciales et public pour les SSIAD souvent gérés par des CCAS ou ces CIAS) compliquant les rapprochements notamment en matière de ressources humaines, de transfert de patrimoine, etc.
Enfin, celle liée à toute restructuration, à savoir l’appréhension des structures et de leur équipe de voir leur organisation modifiée et leurs conditions de travail chamboulées.
Plus qu’une simple peur du changement, les gestionnaires craignent aussi une disparition forcée de leur structure, de leurs valeurs et de leur histoire sous couvert d’une entité juridique unique.
De leur côté, les conseils départementaux et les ARS tentent d’accompagner les services dans la mise en œuvre de cette réforme mais doivent faire face à la complexité de chaque situation qui dépasse leur champ de compétences.
- Quels assouplissements est venue apporter la Loi Bien Vieillir ?
L’article 22 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie (dite « Loi Bien Vieillir ») a prévu plusieurs aménagements, notamment concernant les délais imposés pour la mise en œuvre de cette réforme qui étaient trop courts pour créer des entités juridique uniques porteuses d’autorisation de SAD.
Si ces assouplissements ont permis aux gestionnaires de SSIAD de gagner du temps afin de constituer un SAD mixte, ils n’ont pas résolu les difficultés plus « structurelles » évoquées supra.
Les gestionnaires espèrent encore un nouveau report du délai, voire pour certains, un abandon pur et simple de la réforme par le législateur.
- Quels modes de rapprochement « transitoires » peuvent être envisagés d’ici le 31 décembre 2025 pour permettre aux SSIAD de créer un SAD mixte ?
Ces options sont transitoires car elles leur permettent de créer un SAD mixte sans encore, à ce stade, créer d’entité juridique unique porteuse de l’autorisation :
- La convention transitoire, qui permet, pour une durée de cinq ans maximum[4], de solliciter auprès de l’ARS et du conseil départemental l’autorisation de constituer un SAD dans le cadre d’une convention avec un ou plusieurs services déjà autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile (un SAD mixte ou un SAD aide).
- La création avec un SAD d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) « exploitant », c’est-à-dire non-titulaire de l’autorisation de SAD mixte.
A l’issue du délai prévu par la convention transitoire ou la convention constitutive du GCSMS, le SAD doit être constitué sous la forme d’une entité juridique unique. A défaut, l’autorisation du SAD est réputée caduque.
Ces modes de rapprochement transitoires sont favorisés par les gestionnaires (surtout pour la convention transitoire qui permet à chaque service de conserver son indépendance), les épargnant de « fusionner » ou d’avoir à créer une nouvelle personne morale (le GCSMS) qui rajouterait une surcouche administrative potentiellement complexe à gérer.
Ces options posent toutefois plusieurs questions qui devront être réglées dans la convention notamment concernant les financements, les conditions de mise à disposition du personnel. Il conviendrait également d’anticiper le risque de rupture des relations par l’une des parties à la convention (ou le retrait d’un des membres du GCSMS). Surtout, cela n’épargnera aucunement les gestionnaires de se rapprocher définitivement du ou des services à l’issue du délai prévu par la convention.
- Comment mettre en œuvre le rapprochement définitif ?
Comme leur nom l’indique, les solutions « transitoires » sont par nature… transitoires. A terme, c’est-à-dire à l’issue des cinq années de transition, l’autorisation de SAD mixte devra impérativement être portée par une entité juridique unique.
Pour cela, un rapprochement définitif sera nécessaire. La forme d’un tel rapprochement peut varier selon les profils des parties prenantes ainsi qu’en fonction du projet commun. En synthèse, le rapprochement prendra la forme soit d’une fusion ou d’un transfert d’activité soit de la création d’un GCSMS titulaire de l’autorisation.
Les régimes juridiques de ces modalités de rapprochement pourront varier en fonction des situations de chaque gestionnaire et du projet concerné.
- Ainsi, s’agissant d’un transfert d’activité entre personnes privées constituées sous la forme associative, les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret d’application devront être respectées, qui prévoient une transmission universelle de patrimoine. Au contraire, pour un rapprochement entre opérateurs publics ou entre opérateurs publics et opérateurs privés, les modalités de transfert doivent faire l’objet d’une convention précisant les conséquences de ce transfert sur les moyens matériels et patrimoniaux liés à l’activité cédée.
- De la même manière, un GCSMS relèvera d’un régime de droit public ou de droit privé en fonction du régime de ses membres, ce qui aura un impact direct sur le régime du personnel, le régime de comptabilité ainsi que de l’éventuelle soumission du groupement au Code de la commande publique.
Une telle opération de rapprochement ne s’improvise donc pas et il est d’ailleurs fortement recommandé de mettre en place une feuille de route (ou un rétroplanning de diligences sur une durée raisonnable – en général sur une année).
Plusieurs questions se poseront alors : notamment, en cas de fusion-absorption, laquelle des deux entités sera absorbée ? Quelles seront implications concrètes du transfert du personnel en termes (maintien de la rémunération, du statut collectif, des missions et du statut) ?
Comme de nombreux gestionnaires semblent encore incertains sur le mode de rapprochement définitif à envisager, la conclusion d’une convention transitoire semble être alors une solution salutaire et préconisée pour s’assurer d’une demande d’autorisation unique d’ici le 31 décembre 2025.
Bien entendu, dans l’intervalle, ces gestionnaires auront pu apprendre à fonctionner de manière intégrée grâce à des conventions transitoires, ce qui facilitera peut-être un rapprochement définitif… même si cela n’est pas une certitude.
- Quelles sont les autres conséquences d’un tel rapprochement ?
Cette réforme pose par ailleurs de nombreuses questions qui nécessitent des expertises variées.
- Fusion des systèmes d’information et transfert des données à caractère personnel – Quelle que soit la formule retenue, la mise en œuvre définitive de la réforme nécessitera un transfert d’activité au profit d’un autre gestionnaire ou d’un GCSMS, ce qui n’est pas sans conséquences pratiques par exemple sur la gestion des systèmes d’information.
En effet, qui dit transfert d’activité dit transfert des outils numérique et des données personnelles. L’opération devra, à ce titre, appeler une prudence liée au respect des règles de protection des données à caractère personnel issues du RGPD. Il est donc recommandé aux gestionnaires d’effectuer un travail de vérification des bases légales de leurs traitements et de cartographie des données à transférer pour s’assurer de ne transférer que les données pertinentes. Ce sujet sera réglé soit dans la convention de transfert d’activité (appelé « traité de fusion », « protocole de transfert », « contrat de cession », « contrat d’apport », etc. en fonction de l’opération juridique réalisée) soit dans une convention dédiée au transfert de données. Se posera, enfin, la question des casquettes de chacun : responsable de traitement, uniques ou conjoints, ou sous-traitants ? Ce point pourra également être encadré contractuellement sous la forme d’un contrat de cotraitance ou de sous-traitance.
- Transfert des biens immobiliers – Une autre question qui se posera en cas de transfert sera bien entendu le sort des contrats de bail en cours qui ne sont pas toujours transférés par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine. Aussi, toutes les opérations de rapprochements n’entrainent pas toujours de transmission universelle de patrimoine, ce qui nécessitera de s’assurer contractuellement de la continuation des contrats en cours et tout spécialement des baux, même si on sait que s’agissant de services autonomie à domicile, la question se pose avec moins d’urgence.
- Impacts RH – Selon que les gestionnaires soient de droit public ou de droit privé, les impacts liés au transfert des salariés ou des agents ne sera pas le même et impliquera des conséquences en droit social ou en droit de la fonction publique.
- En conclusion, la réforme souffre d’un manque d’anticipation de part et d’autre
A quelques mois de la date butoir du 31 décembre 2025, on observe chez les gestionnaires un manque de préparation qui n’est pas que de leur fait. En effet, cette réforme a été amenée comme une réforme nécessaire et salutaire, ce qu’elle est probablement, toutefois, on observe en réalité qu’elle est particulièrement complexe à mettre en place, pour les raisons évoquées supra et aussi parce qu’elle implique de fortes contraintes liées au cahier des charges telles que par exemple l’obligation de faire coïncider les zones d’intervention.
Un report de cette date butoir ne semble cependant pas envisagé par les pouvoirs publics.
Sur tous ces sujets, le cabinet Seban & Associés accompagne ses clients dans la mise en œuvre de la réforme, que ce soit pour la mise en place d’une convention transitoire ou d’un rapprochement définitif ainsi que pour tous les sujets connexes qui se posent tels que la conclusion d’une convention de transfert de données personnelles et d’une convention de cotraitance.
Notre accompagnement, en lien avec nos partenaires dans les domaines financiers et organisationnels, porte également sur l’identification des avantages et inconvénients de chaque option.
Nous vous invitons, à cet égard, à vous inscrire à notre formation prévue le 5 juin prochain et qui traitera spécifiquement des modalités de rapprochements et de coopération dans le secteur médico-social dans le contexte de la réforme SAD.
______
[1] Article L. 313-1-3 du Code de l’action sociale et des familles
[2] En effet, si la réforme prévoit que les SSIAD peuvent également créer une nouvelle activité, de nombreuses autorités ont indiqué qu’elles ne délivreront pas de nouvelles autorisations.
[3] A noter toutefois que, depuis la loi Bien vieillir du 8 avril 2024 et son article 22, en cas de rejet de la demande par l’ARS et du conseil départemental, le SSIAD reste autorisé pour son activité pour une durée maximale de 2 ans à compter de la notification de la décision de rejet. Cela doit lui permettre de bénéficier d’un délai supplémentaire pour améliorer son projet ou le faire évoluer. Après ce délai de 2 ans et à défaut de transformation en SAD mixte, l’ARS pourra mettre fin à l’autorisation du SSIAD sur le fondement de l’article L. 313-15 du CASF.
[4] Si le décret du 13 juillet 2023 prévoyait initialement un conventionnement pour une durée maximale de 3 ans, l’article 22 de la loi Bien vieillir est venu allonger ce délai à 5 ans.