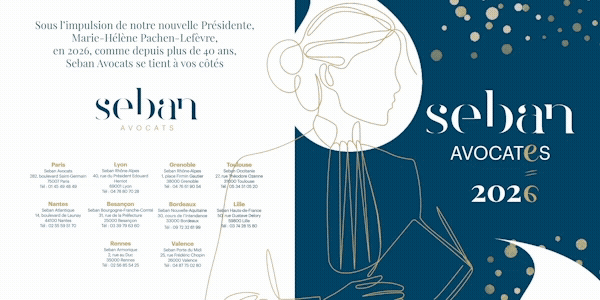Adoptée à la surprise générale le 15 octobre 2025, la loi de simplification de l’urbanisme traduit la volonté du Gouvernement de répondre rapidement aux critiques formulées par les élus locaux et les professionnels du secteur face à la complexité croissante des procédures.
Cette loi modifie en profondeur plusieurs pans du droit de l’urbanisme avec un objectif clair : faire sortir les projets.
Sans grande surprise, plusieurs parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel, invoquant notamment une atteinte au droit au recours.
I. Evolution des documents d’urbanisme
Exclusion de l’évaluation environnementale pour certaines modifications du PLU
La proposition de loi complète l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme afin de préciser que les procédures de modification d’un PLU ayant pour seul objet soit la rectification d’une erreur matérielle, soit la réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser, ne sont plus soumises à évaluation environnementale.
Evolutions du PLU
Si le code de l’urbanisme prévoit actuellement quatre procédures d’évolution du PLU, à savoir la révision, la révision simplifiée, la modification, et la modification simplifiée, il est désormais prévu de pérenniser uniquement les procédures de révision et de modification.
La procédure de révision sera mise en œuvre lorsqu’il est décidé de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), sauf dans les cas où les changements ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, au sens des codes de l’énergie et de l’urbanisme, qui nécessiteront donc uniquement une procédure de modification du PLU. De même, une procédure de modification du PLU pourra être mise en œuvre pour la délimitation des secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements ou les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation sont à usage exclusif de résidence principale. Enfin, une procédure de modification pourra également s’appliquer, si l’autorité compétente le décide, pour les changements des orientations du PADD ayant pour objet de délimiter les zones exposées au recul du trait de côte. Les modalités de mise à disposition du projet de modification sont celles actuellement posées à l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme concernant la modification simplifiée.
Evolutions du SCOT
Comme le PLU, l’évolution du SCOT ne pourra désormais être réalisée que par une procédure de révision ou une procédure de modification. En outre, le code de l’urbanisme précisera que sous réserve des cas où une révision du SCOT s’impose, il fera l’objet d’une procédure de modification. Plus précisément, la révision est nécessaire lorsque l’établissement public chargé de son élaboration envisage des changements portant sur les orientations définies par le projets d’aménagement stratégique (PAS), sauf, là encore, pour les changements ayant pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité et de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, au sens des codes de l’énergie et de l’urbanisme, qui seront soumis à la procédure de modification. Les modalités de mise à disposition du projet de modification sont celles actuellement posées à l’article L. 143-38 du code de l’urbanisme concernant la modification simplifiée. Enfin, l’analyse des résultats de l’application du ScoT interviendra au bout de dix ans et non plus six ans.
Promotion du recours à la PPVE
La proposition de loi encourage, par décision motivée du président ou du maire compétent, la mise en œuvre de la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE), en substitution d’une enquête publique pour que le public se prononce sur un projet d’élaboration ou de modification du ScoT ou du PLU.
Lorsque la PPVE est mise en œuvre, le dossier devra également être mis à disposition sur support papier en consultation, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. Par ailleurs, lorsque la modification du SCOT ou du PLU ne concerne que certaines communes, l’enquête publique ou la PPVE ou la mise à disposition du public peut n’être organisée que sur les territoires des communes concernées par cette modification. Enfin, lorsque le projet de modification du SCOT ou du PLU est soumis à évaluation environnementale en application du code de l’urbanisme, le recours à la PPVE ou à l’enquête publique est obligatoire.
Création d’un document d’urbanisme unique
La loi créé un document d’urbanisme unique regroupant le PLUi et la SCOT, lorsque leurs périmètres sont identiques. Ce document comprendra un rapport de présentation ; un projet d’aménagement stratégique (PAS) intercommunal ; des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; un règlement ; des annexes. Ce document devra bien évidemment être compatible avec les schémas de mise en valeur de la mer, les plans de mobilité et les programmes locaux de l’habitat. Il sera élaboré, révisé, modifié et évalué selon les mêmes modalités qu’un PLU et un SCOT classiques. (L. 146-1 code de l’urbanisme)
Schéma d’aménagement régional (SAR)
Le projet d’élaboration du SAR ou sa révision adoptée par l’assemblée délibérante doit être transmis non plus au ministre chargé de l’urbanisme mais au représentant de l’Etat pour approbation par arrêté. Si des raisons liées à l’illégalité de certaines orientations ou dispositions du SAR, ou l’atteinte qu’elles sont susceptibles de porter aux intérêts nationaux, font obstacle à l’approbation de celui-ci, le préfet notifiera à l’assemblée délibérante, par décision motivée, les modifications à apporter au SAR. L’assemblée délibérante disposera alors d’un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte, par une nouvelle délibération, les modifications sollicitées par le préfet. (L. 4433-10-3 CGCT)
II. Disposition en faveur de la réalisation des projets et des logements
ZAE
La loi introduit une piste d’optimisation foncière avec le nouvel article L. 152-6-7 du code de l’urbanisme permettant, dans le périmètre des ZAE, de déroger aux destinations fixées par le PLU pour permettre la réalisation de logements et d’équipements publics. Cela vient compléter les dispositions en faveur de la réutilisation des ZAE prévues par la loi Climat et Résilience. Sous certaines conditions, l’autorité qui instruit la demande d’autorisation peut également déroger aux règles relatives à l’emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l’aspect extérieur des bâtiments ainsi qu’aux obligations en matière de stationnement.
Les logements ainsi créés peuvent être soumis à une obligation d’usage en tant que résidence principale.
Etudiants
Le nouvel article L. 152-6-8 prévoit la possibilité de déroger par décision motivée dans les zones U et AU aux règles du PLU pour permettre la réalisation d’opérations de logements destinés spécifiquement à l’usage des étudiants.
Réhabilitation des bâtiments à usage agricole
Le nouvel article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité de déroger aux dispositions relatives aux destinations organisées par le PLU pour autoriser le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière.
Cette dérogation nécessite l’avis conforme de l’autorité chargée du PLU.
En zones agricoles, naturelles ou forestières, cette dérogation n’est envisageable que si le bâtiment n’a plus servi à une activité agricole ou forestière depuis plus de vingt ans, et sous réserve :
- En zone agricole, de l’avis conforme de la CDPENAF ;
- En zone naturelle, de l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Cristallisation droit opposable aux PCM
Le texte consacre un principe fort de stabilité des autorisations d’urbanisme. Désormais, en vertu des nouveaux articles L. 431-6 et L. 441-5 du code de l’urbanisme, une demande de permis (de construire ou d’aménager) modificatif présentée dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis initial ne peut être refusée ni assortie de prescriptions sur le fondement de règles d’urbanisme adoptées postérieurement, sauf si ces règles répondent à des impératifs de sécurité ou de salubrité publique. C’est à la condition également que les travaux autorisés par le permis initial ne soient pas achevés.
Ce dispositif a pour objectif d’éviter qu’un projet déjà engagé soit fragilisé par des évolutions réglementaires ultérieures.
Prolongation des permis précaires
Par ailleurs, l’article L. 433-2 modifié introduit une plus grande souplesse pour les permis précaires, dont la durée de validité peut désormais être prolongée au-delà du terme initial, à l’issue duquel le pétitionnaire devait normalement procéder à la dépose des constructions autorisées.
Obligations de stationnement
Plusieurs dispositions de la loi prévoient des règles plus souples en matière d’aires de stationnement, notamment :
- Le texte prévoit deux dispositions pour les travaux sur existant. D’une part, sous certaines conditions, il peut être dérogé aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements pour les travaux de transformation ou d’amélioration effectués sur des logements existants qui n’entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire supérieure à 30 % de la surface existante. D’autre part, pour les opérations de réhabilitation d’immeubles en centre-ville, la collectivité compétente peut, par délibération motivée, déroger à l’obligation de création de places de stationnement prévue par le règlement du plan local d’urbanisme.
- La loi prévoit la possibilité pour le règlement du PLU de réduire les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé dans les secteurs délimités.
- La loi étant le champ de l’article L.151-34 du code de l’urbanisme qui abaisse le nombre de places de stationnement à réaliser pour certains projets. Cet abaissement pourra désormais s’appliquer aux logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire de l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation et aux logements-foyers de l’article L.633-1 du CCH.
- L’article L. 151-31 du code de l’urbanisme prévoyait d’ores et déjà que les obligations en matière de stationnement peuvent être réduites d’au moins 15% dans l’hypothèse où les constructeurs mettent à disposition des véhicules électriques ou propres en autopartage.
La loi Huwart fait passer le seuil de 15 à 30%, et prévoit que cette réduction peut également être envisagée si une aire de covoiturage existe dans l’environnement immédiat de l’opération.
- Par ailleurs la loi modifie l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme pour prévoir que le rayon de 500 mètres autour d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre dans lequel il est possible de déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements, est étendu à un rayon de 800 mètres.
- En outre, pour les petites opérations de logements (au maximum dix logements), les obligations en matière de place de stationnement pourraient être tenu quitte des obligations relatives au stationnement en ayant recours à “une aire de stationnement mutualisée”, dans les conditions définies par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme.
Transformation des résidences hôtelières à vocation sociale
Pendant dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, dans les territoires à forts besoins en logement (zones de développement économique, d’industrialisation ou accueillant des travailleurs saisonniers ou mobiles), il sera possible de conclure un protocole local entre le préfet, l’exploitant, le département et l’EPCI concerné.
Ce protocole définira les conditions de transformation d’une résidence hôtelière à vocation sociale nouvellement créée en logements, notamment en logements sociaux, ainsi que l’échéance à laquelle cette transformation doit intervenir.
Faciliter les surélévations
Diverses dispositions de la loi tendent à faciliter la surélévation des bâtiments, afin de favoriser la densification de l’existe, dans la continuité des principes de la loi Climat & Résilience.
- D’une part, écartant en tout état de cause l’application de la jurisprudence Sekler du 27 mai 1988 (n°79530), la loi, introduisant un nouvel article L. 111-35 du code de l’urbanisme, prévoit que lorsqu’une construction régulièrement édifiée fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation limitée d’un immeuble existant, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée sur le seul fondement de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d’implantation, d’emprise au sol et d’aspect extérieur des constructions.
- D’autre part, la loi étant le bénéfice des dérogations prévues à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme en supprimant leur seul bénéfice aux “communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation”.
Et une nouvelle dérogation est intégrée à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme pour pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement.
III. Dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme
Moyens soulevés par voie d’exception d’illégalité
L’actuel article L. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que les moyens tirés d’un vice de forme ou de procédure d’un ScoT, d’un PLU, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ne peuvent être invoqués par voie d’exception, que dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause.
Par exception, cet article dispose que ce délai de six mois n’est pas applicable pour les moyens de vices de forme tirés de la méconnaissance substantielle ou de la violation des règles de l’enquête publique sur ces documents, et de l’absence de rapport de présentation ou des documents graphiques, qui peuvent donc être soulevés à tout moment.
La loi abroge cet article en vue d’harmoniser le droit de l’urbanisme avec le droit commun et ainsi appliquer la jurisprudence CFDT n°414583 du 18 mai 2018 du Conseil d’Etat.
Pour rappel, cette jurisprudence avait indiqué que les vices de légalité externe d’un acte réglementaire ne peuvent être constaté qu’à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même dans le délai de recours contentieux. Le Conseil d’Etat jugeait à l’occasion de cette décision que la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées dans le cadre d’un recours par voie d’exception ou d’un recours contre le refus d’abrogation de l’acte réglementaire. En revanche, le Conseil d’Etat indique que tel n’est pas le cas des conditions d’édiction de cet acte, des vices de forme e tde procédure. Ainsi, ces derniers moyens ne peuvent plus être invoqués à l’expiration du délai de recours contre l’acte réglementaire.
Mais l’article L. 600-1 continuait de prévoir que l’illégalité pour vice de forme ou de procédure des SCOT et PLU pouvaient être invoquée par voie d’exception à l’occasion d’un recours dirigé contre un permis de construire par exemple, mais dans la limite d’un délai de six mois, sauf concernant les méconnaissances substantielles ou la violation des règles de l’enquête publique ou encore l’absence de rapport de présentation ou des documents graphiques.
Ainsi, en définitive, cela faisait coexister deux situations :
- Le cas des demandes d’abrogation à l’occasion desquelles ne pouvaient plus être invoqués les vices de forme et de procédure, quelle que soit leur nature : on applique la jurisprudence CFDT.
- Le cas des recours contre les autorisations d’urbanisme à l’occasion desquelles peuvent être soulevés, par voie d’exception, les moyens de forme et de procédure, dans la limite seulement de 6 mois, ce délai n’étant pas opposable à certains moyens énumérés dans l’article L. 600-1 : dans ce cas donc ne s’applique pas la jurisprudence CFDT mais l’article L. 600-1.
En supprimant l’article L. 600-1, la loi vient gommer cette différence, et ne plus appliquer que la jurisprudence CFDT.
Cette disposition fait partie des motifs du recours porté par divers parlementaires devant le Conseil constitutionnel afin de maintenir les exceptions initialement prévues par l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.
Intérêt à agir
L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme est complété en ce qu’il soumet à une nouvelle condition l’intérêt à agir des requérants autres que l’Etat, les collectivités territoriales ou un groupement, c’est-à-dire notamment une personne privée physique ou morale, et les associations, contre les documents d’urbanisme. En application de ce nouvel article, afin d’être recevables à former un recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme, le requérant devra démontrer qu’il a bien pris part à la participation du public effectuée par enquête publique, par voie électronique ou par mise à disposition organisée dans le cadre de l’élaboration du document qu’il entend contester.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par des parlementaires qui estiment qu’il s’agit d’une restriction au droit au recours effectif, et que les modalités de cette participation ne sont pas précisées par la proposition de loi.
Cristallisation des motifs de substitution
La proposition de loi modifie l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme pour prévoir que l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme qui a refusé une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol qui a fait l’objet d’un recours en annulation ou l’objet d’une demande de réformation d’une décision juridictionnelle concernant sa décision, ne pourra plus, au-delà d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande, invoquer de nouveaux motifs de refus pour justifier la légalité de sa décision devant le juge administratif. A ce jour, aucun délai n’est fixé pour une substitution de motifs au bénéfice de l’administration.
Présomption d’urgence en référé-suspension
La proposition de loi modifie l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour étendre la présomption d’urgence du référé-suspension contre une autorisation d’urbanisme délivrée au référé-suspension introduit contre un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme.
Délai de recours gracieux/hiérarchique
La loi introduit un nouvel article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit que le délai pour introduire un recours gracieux/hiérarchique est réduit de deux mois à un mois. Ce délai de recours ne sera donc plus calqué sur le délai de recours contentieux de deux mois. Par ailleurs, le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours gracieux vaudra toujours décision de rejet mais ce recours gracieux ne prorogera plus le délai de recours contentieux. Ainsi, le délai global, même en cas de recours gracieux, sera de 2 mois, à compter de l’affichage sur le terrain.
Le Conseil constitutionnel a été saisi sur ce point par des parlementaires qui lui reprochent le fait que la décision implicite de rejet née à l’issue du délai de deux mois sera dénuée de toute utilité et de toute portée normative. En outre, il est reproché à cet article de ne pas prévoir de mécanisme pour prévenir l’auteur du recours gracieux que son recours ne prolonge pas le délai de recours contentieux de deux mois.
IV. Dispositions spécifiques à l’aménagement
L’opération de transformation urbaine
Afin de lutter d’une part, contre l’extension urbaine et d’autre part, contre la crise du logement, le législateur a souhaité valoriser les fonciers peu densifiés, fortement consommateur d’espace.
A cette fin, un amendement a été déposé lors de l’examen à l’Assemblée nationale de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, visant à créer un nouveau dispositif, appelé « opération de transformation urbaine » (OTU) (nouvel article L. 315-1 C.Urb).
Précisément, cet amendement introduit un article 2 ter qui reprend les dispositions de l’article 5 du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements durables, déposé au Sénat le 6 mai 2024 et dont l’objet était de « faciliter la transformation urbaine des zones pavillonnaires et des zones d’activité économique (ZAE).
Deux secteurs sont ainsi concernés : les zones pavillonnaires d’une part et les ZAE d’autre part.
Et pour comprendre l’OTU, il convient de retenir que celle-ci a été conçue par le législateur comme la traduction opérationnelle d’une nouvelle OAP (nouvel article L. 151-7-3 C.Urb) – également créée par cette loi de simplification – dont l’objectif est d’offrir aux collectivités un moyen d’optimiser la densité urbaine tout en respectant des objectifs de qualité environnementale, urbaine, paysagère, et architecturale.
En d’autres termes, le législateur a prévu un mécanisme à deux niveaux.
Tout d’abord, par le biais d’une OAP spécifique, l’autorité compétente en matière de PLU identifiera certains secteurs pavillonnaires ou certaines ZAE dont elle souhaite favoriser l’évolution, la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle.
Puis, elle fixera les objectifs, la durée, le(s) périmètre(s) de(s) opération(s) ainsi que le programme prévisionnel des actions à réaliser et les conditions de financement de l’opération pour les besoins en équipements publics.
L’OTU a donc pour objet de mettre en œuvre les orientations d’aménagement et de programmation définies préalablement.
Et concrètement, cette OTU sera définie par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU.
La délibération créant l’OTU devra ainsi déterminer :
- les objectifs ;
- la durée ;
- le ou les périmètres de l’opération ;
- le programme prévisionnel des actions à réaliser ;
- l’estimation du coût de l’opération ;
- et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.
Les actions à conduire dans le cadre de cette opération peuvent soit être réalisées en régie par la collectivité, soit être confiées à un « opérateur » désigné par elle et, le cas échéant, donner lieu à une convention.
Comme l’explique l’amendement, l’enjeu de l’OTU « est d’inciter les acteurs des territoires à envisager les zones pavillonnaires existantes et les ZAE comme des « espaces de projets » à valoriser, à faire évoluer voire à revitaliser ».
Et le législateur a prévu une procédure de participation du public, l’instauration de cette OTU devant faire l’objet au préalable d’une procédure de concertation.
La difficulté résulte naturellement dans le fait que ces secteurs ne se prêtent pas aux procédures d’aménagement et de maîtrise foncière habituelles.
Afin d’atteindre ses objectifs de densification, l’OTU doit donc offrir aux collectivités locales de nouveaux outils.
En ce sens, le législateur prévoit également de favoriser et d’assouplir la modification des documents du lotissement (art. L. 442-11 C.Urb) les règles régissant ce dernier ayant généralement pour effet de figer la constructibilité́ de ces espaces.
Deux assouplissement sont alors prévus.
Premièrement, il est prévu un abaissement des règles de majorité qualifiée des colotis pour demander ou accepter la modification de l’ensemble des règles contenues dans les
documents de lotissement.
La mesure permet de passer de l’accord de la moitié des propriétaires détenant les deux tiers de la superficie du lotissement, ou l’accord des deux tiers des propriétaires détenant la moitié de la superficie à l’accord de la moitié des propriétaires détenant la moitié de la superficie du lotissement.
Deuxièmement, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme pourra modifier, après enquête publique, l’ensemble des documents du lotissement (règlement et cahier des charges) pour les mettre en concordance avec l’évolution des règles d’urbanisme applicables sur le lotissement dans le cadre de la mise en place de ces nouvelles OAP et OTU.
L’objectif est ainsi de s’assurer que le règlement et le cahier des charges des documents du lotissement ne fassent pas obstacle à la mise en œuvre des OAP et OTU.
Le permis d’aménager multi-sites
Le permis d’aménager multi-sites (PAMS) est un permis d’aménager dérogeant au principe de contiguïté des parcelles sur lesquelles doivent en principe se trouver les projets soumis à permis d’aménager.
La loi de simplification doit ainsi permettre de généraliser cet outil créé à titre expérimental (pour 5 ans) par la loi ELAN du 23 novembre 2018[1] avant d’être pérennisé et élargi par la loi 3DS du 21 février 2022[2].
Les retours d’expérience témoignent de la pertinence de cet outil et de son appropriation progressive par les collectivités locales concernées, cet outil permettant de rationaliser plusieurs procédures.
Concrètement, le PAMS doit permettre de corréler plusieurs unités autour d’un seul et même projet cohérent en garantissant la bonne insertion architecturale et paysagère, ce qui est nécessairement plus difficile en présence de plusieurs permis d’aménager décorrélés les uns des autres.
En outre, le service instructeur disposera ainsi d’une vision plus globale des projets en cause.
Pour mémoire, l’article 112 de la loi 3DS prévoyait la possibilité d’obtenir un PAMS, sous réserve que l’opération garantisse l’unité architecturale et paysagère des sites concernés, et dans deux hypothèses seulement :
- Le PPA : dans le cadre d’une opération d’aménagement prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement (C. urb., art. L. 312-2-1) ;
- L’ORT : pour la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire dont le but est de revitaliser des centres-villes ou bourgs centres dont le foncier est nécessairement morcelé et discontinu (CCH, art. L. 303-2).
Désormais, la loi de simplification supprime ces articles et crée un nouvel article L. 442-1-3 dans le code de l’urbanisme qui prévoit la possibilité d’obtenir un PAMS sous réserve de respecter les trois conditions suivantes :
- le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés ;
- la demande de permis doit être déposée par un demandeur unique ;
- le projet constitue un ensemble unique et cohérent.
[1] loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
[2] loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
V. Dispositions diverses
De nouvelles sanctions
La loi renforce sensiblement les pouvoirs de sanction du maire en matière d’urbanisme. Désormais, en vertu de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la réforme, le maire (ou l’autorité compétente) peut, en plus de la mise en demeure de régulariser ou de déposer une autorisation, prononcer une amende administrative pouvant atteindre 30.000 euros.
Cette amende peut être cumulée avec une astreinte journalière, dont le montant maximal est doublé — porté de 500 à 1.000 euros par jour, dans la limite de 100.000 euros (contre 25. 000 euros auparavant).
En cas d’inaction du maire, le préfet pourra désormais se substituer à lui pour faire exécuter ces mesures
Ce renforcement traduit une volonté claire du législateur de rendre plus effective la répression des infractions au droit de l’urbanisme, longtemps jugée lente et peu dissuasive.
Par ailleurs, l’article L. 481-1 prévoyait que la construction non régularisable pouvait faire l’objet d’une démolition complète aux frais de l’intéressé après y avoir été autorisé par un jugement du président du tribunal judiciaire, lorsqu’elle présente un risque certain pour la sécurité ou pour la santé. La loi ajoute ou lorsqu’elle se situe hors zone urbaine.
Solarisation
La loi de simplification de l’urbanisme est de nouveau l’occasion pour le législateur de réviser les règles relatives à la végétalisation ou à la production d’énergies renouvelable sur les toitures et les parcs de stationnement.
La loi de simplification modifie les règles issues de la loi APER (article 40 de la loi APER du 10 mars 2023) relatives à la couverture partielle des grands parkings (plus de 1.500 m²) par des ombrières photovoltaïques.
- D’une part, la loi organise, sous certaines conditions (notamment dans le cas où le fournisseur de panneaux ferait faux bond à l’acquéreur), le report possible du délai d’équipement des parcs de stationnement extérieurs pour les parcs de stationnement qui ne sont pas gérés en concession ou en délégation de service public.
- D’autre part, l’article 40 de la loi APER précise que l’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs photovoltaïques. Cette règle est inscrite dans le code de l’urbanisme à l’article L. 111-19-1.
- Par ailleurs, la loi prévoit jusqu’à présent une obligation d’équipement des parcs de stationnement extérieurs supérieurs à 1.500 m², sur au moins 50% de leur superficie d’ombrières équipées d’ouvrages de production d’énergie renouvelable. La loi de simplification prévoit la possibilité de prévoir un procédé mixte pour couvrir au moins la moitié du parc de stationnement composé :
- D’ombrières couvrant au moins 35% de la moitié de la superficie des parcs
- Et de dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la surface restant à couvrir.
- Enfin, la loi réorganise quelque peu les cas où l’installation des ombrières n’est pas imposée. La loi prévoit déjà que l’obligation d’installation d’ombrières n’est pas obligatoire s’il est installé un autre dispositif de production d’énergie renouvelable qui produit au moins autant d’énergie et qui ne nécessite pas l’installation d’ombrières. La loi de simplification prévoit que le propriétaire peut faire autre chose que tout ou rien (c’est-à-dire soit tout ombrières, soit tout autre procédé de création d’énergie renouvelable) : il peut remplir ses obligations avec à la fois une partie ombrières et une partie autre procédé de création d’énergie.
Etablissements publics foncier (EPF) d’Etat et locaux
La loi prévoit que le périmètre d’un EPF de l’Etat peut être étendu ou réduit par décret au territoire d’un EPCI à fiscalité propre ou d’une commune, lorsque l’organe délibérant de ce dernier en a fait la demande et après que le conseil d’administration de l’EPF d’Etat concerné a délibéré en ce sens. S’agissant des EPF locaux, la loi autorise l’extension d’un périmètre d’un EPF local à une commune membre d’un EPCI à fiscalité propre n’adhérant pas à l’EPF local. Enfin, lorsque le périmètre d’un EPF local est étendu à un EPCI à fiscalité propre dont l’une des communes membres adhère déjà à l’EPF local, l’EPCI se substituera de plein droit à cette commune dans les organes de l’EPF local et dans ses délibérations et actes pris par ce dernier.
Biens sans maîtres
La loi vient réduire le délai à l’issue duquel la commune devient pleinement propriétaire, le passant de trente à quinze ans. Ainsi, les immeubles dont le propriétaire est décédé et dont la succession est ouverte depuis plus de quinze ans, intégreront de plein droit le patrimoine de la commune sur laquelle il est situé. Cette règle s’appliquera aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 et non encore partagées. La loi précise que l’administration fiscale devra, sur demande du maire ou du président de l’EPCI, transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition de ces biens sans maître, à charge pour la commune ou l’EPCI, s’agissant de ces biens « définitivement » sans maîtres, de justifier d’un doute légitime sur l’identité ou la vie du propriétaire.
La densité minimale des constructions peut désormais être fixée dans toutes les zones du PLU, et non plus uniquement à proximité des lignes de transport. Cette mesure permet de lutter contre l’étalement urbain et de favoriser une urbanisation plus compacte.